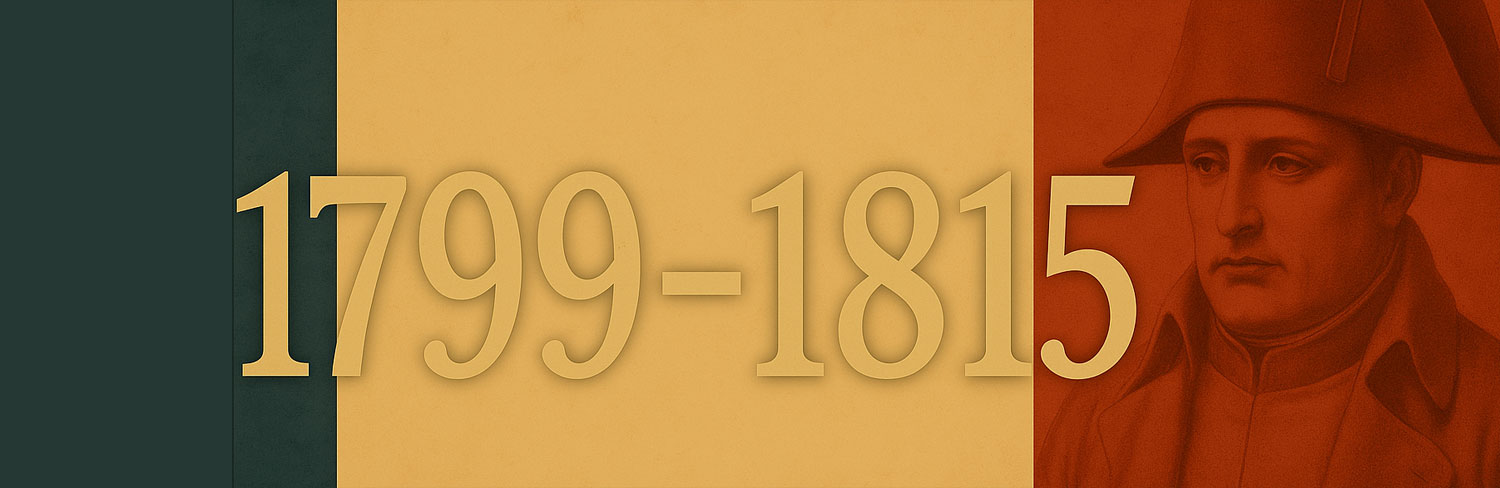
Villennes au fil du temps : de 1799 à 1815
De 1799 à 1802 : fin du Directoire et Consulat
De Mantoue à Acqueville
L’année 1799 est agitée par des événements aussi bien intérieurs qu’extérieurs ; pendant que Bonaparte mène la campagne d’Egypte, en Italie nos armées subissent des revers importants. En particulier le 30 juillet, la garnison de Mantoue, commandée par le général Kray, qui est assiégée par les Autrichiens, capitule. Il en résulte une grande émotion en France ; on parle même de trahison.
Le gouverneur de la ville de Mantoue, le général François Philippe de Latour Foissac, a eu d'importantes difficultés à défendre cette ville (hostilité de la population, environ deux mille soldats malades et hospitalisés) et a obtenu les honneurs de la guerre de la part des Autrichiens. Il est néanmoins destitué, le 24 juillet 1800, par un arrêté des Consuls qui lui interdit le port de l’uniforme. De retour en France, il acquiert le château d’Acqueville, où il décèdera le 11 février 1804, quelques mois après sa femme ; tous deux sont inhumés dans la chapelle du château.
Pendant le siège de Mantoue, son second fils François Marie Louis Victor de Latour Foissac, qui est jeune sous-lieutenant, est son aide de camp. Il résidera lui aussi quelques années plus tard au château d’Acqueville.
Le Consulat introduit une nouvelle organisation des départements et des communes
Sur le plan intérieur, la situation se dégrade également. Les coups d’état permanents du Directoire ne peuvent que provoquer celui du 30 prairial (18 juin 1799), où le Conseil des Cinq Cents et le Conseil des Anciens obligent deux directeurs à démissionner. A partir du mois d’août, les luttes royalistes reprennent dans l’ouest et le midi de la France.
 |
Le 9 octobre, Bonaparte est de retour en France. Il prépare avec l’aide de son frère, qui est président du
Conseil des Cinq Cents, le coup d’état du 18 brumaire
(9 novembre 1799), qui se traduit par la nomination de trois
consuls provisoires : Bonaparte, Sieyès et Ducos. "Bonaparte se présente devant le Conseil des Cinq Cents", tableau de Bouchot, commande de Louis-Philippe pour le musée historique de Versailles. |
Le 15 décembre 1799, le Consulat commence avec la proclamation de la Constitution de l’An VIII ; celle-ci est ratifiée, le 7 février 1800, par un plébiscite dont le résultat est le suivant :
| Votants | 3 012 569 |
| Oui | 3 011 007 |
| Non | 1 562 |
Le gouvernement réglemente aussitôt l’administration départementale et l’autorité municipale. Tandis que la Constitution de l’An III n’avait confié aux commissaires du Directoire de département que des pouvoirs restreints, le préfet, nouvel agent du pouvoir exécutif, est investi des droits les plus absolus en ce qui concerne l’administration du département ; le Conseil général n’intervient désormais que sur les finances du département :
- Répartition entre les arrondissements du contingent des contributions directes ;
- Vote des impôts départementaux dans les limites fixées par la loi ;
- Contrôle du compte annuel présenté par le préfet pour l’emploi des crédits du budget.
Le rôle des assemblées départementales est donc complètement effacé : leurs membres ne sont plus que les auxiliaires du pouvoir exécutif représenté par le préfet.
Le premier préfet du département de Seine et Oise est Germain Garnier, ancien administrateur du département de la Seine.
Une transformation analogue est opérée dans les communes. Il y a désormais dans chacune d'elles, quelle que soit son importance, un maire et un conseil municipal, qui ne sont plus élus mais nommés :
- Les conseillers municipaux par le préfet sur les listes de notabilité ;
- Les maires et les adjoints par le Premier consul dans les villes de plus de 5 000 habitants et par le préfet pour les autres communes.
Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d’entre eux qu’ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre de citoyens ayant droit d’y coopérer. C’est dans cette première liste de notabilité communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l’arrondissement.
Les citoyens compris dans les listes communales d’un département désignent également un dixième d’entre eux. Il en résulte une seconde liste dite liste départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département.
Les citoyens portés sur la liste départementale désignent pareillement un dixième d’entre eux, pour former une troisième liste qui comprend les citoyens du département éligibles aux fonctions publiques nationales.
Pour figurer sur ces listes, il faut être né en France et y résider au moins depuis un an, être âgé de 21 ans accomplis et être inscrit sur le registre civique de son arrondissement communal ; il ne faut pas avoir eu de condamnation afflictive ou infamêtre en l’état de débiteur failli, ni être en l’état de domestique à gages.
Nomination du conseil municipal de Villennes
Dès la mise en place du Consulat, les agents municipaux et les adjoints en place sont nommés respectivement maires provisoires et adjoints provisoires. Après la proclamation de la Constitution et l'entrée en fonction des préfets, la nomination du nouveau maire de Villennes est officiellement proclamée le 30 prairial de l’An VIII (19 juin 1800) :
Aujourd’hui 30 prairial de l’An VIII de la République Française une et indivisible, heure de midy, nous Maire et Adjoint provisoire de la commune de Villennes, canton de Poissy, département de Seine et Oise.
En vertu des ordres à nous transmis par le préfet du département de Seine et Oise, nous avons procédé à l’installation du citoyen Henry Le Large aux fonctions de Maire et le citoyen Benoît Rédaux à celle d’Adjoint de la dite commune de Villennes qui après avoir reçu d’eux le serment de fidélité à la République, nous avons signé le présent registre.
Maire provisoire Ménard Adjoint provisoire Lesueur
Maire Henry Le Large Adjoint Benoît Rédaux
Modification de la limite territoriale entre Villennes et Médan
Le 22 mai 1801, sur réclamation de la commune de Médan, les deux conseils municipaux se réunissent afin de régler le différend qui les oppose sur la limite territoriale des deux communes sur l’île des Couleuvres (île du Platais). Ils prennent la décision suivante :
Ce jourd’hui 2 prairial An IX de la République Française, les conseils municipaux de la commune de Villennes et Médan réunis au lieu ordinaire de nos séances à l’effet de terminer la difficulté sur la réclamation faite par la commune de Médan relativement à la réunion à son territoire de l’îsle des Couleuvres qui lui avait été enlevée depuis plusieurs années, faute des titres ou plan des territoires respectifs qui étaient déposés au sein des anciennes administrations supprimées. Les deux conseils en présence des maires de Villennes et Médan désirant terminer à l’amiable la présente difficulté, ont chacun en ce qui les concerne exposé sur le bureau le tableau ou plan de leur territoire respectif et d’après la lecture du procès verbal des plans et la vue jetée sur les deux plans, il a été reconnu à l’unanimité que la demande de la commune de Médan est de toute justice qu’elle est son plein et entier effet, que conséquemment les démarcations tracées sur les deux plans respectifs seront à commencer de ce jour et pour la suite, la seule ligne de limite entre les deux communes et qu’ainsi la pointe de la dite îsle des Couleuvres, dans l’alignement des bornes des deux communes restera à celle de Villennes et l’autre partie à celle de Médan. Pourquoi avons pris le présent arrêté pour servir aux deux communes ce que de raison à Villennes les dits jours, mois et an de la République Française.
Signé : H. Lelarge, Maire de Villennes Rouleau, Maire de Médan
 |
Cet acte sera enregistré définitivement à Poissy, le 25
février 1807. |
L'établissement de la mairie
Pour la première fois dans les délibérations du conseil municipal de Villennes, il est fait mention de la mairie, qui se trouve vraisemblablement dans l’ancienne maison des sœurs.
Le 3 brumaire An X (25 octobre 1801), le conseil municipal est convoqué extraordinairement par le maire pour approuver les dépenses, s'élevant à 31 francs, à faire pour l’établissement de la mairie.
De 1802 à 1804 : la Constitution de l'an X
Le Consulat à vie
L’évolution autoritaire du Consulat est très nette pendant l’année 1802 et tout bascule avec l’instauration du Consulat à vie au cours de l’été. Après la signature de la paix d’Amiens, le 25 mars, entre la France, l’Espagne, la Hollande et l’Angleterre, notre pays est en paix pour la première fois depuis près de dix ans. Le Concordat est également signé ; c’est donc dans la joie de la paix intérieure et extérieure que l’opinion se rallie sans difficulté à la proposition gouvernementale.
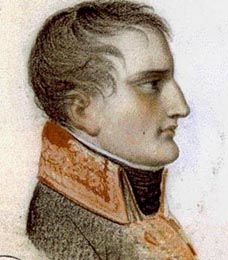 |
Sur décision du sénat du 18 floréal An X (8 mai 1802), un plébiscite est organisé, avec la question suivante : "Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie ?”. Sur des registres ouverts dans les mairies, les électeurs viennent y répondre par oui ou non, en mettant leur nom à côté de leur choix. La consultation a lieu, dans le département de Seine et Oise, pendant trois semaines à partir du 27 floréal An X (17 mai 1802). |
Les résultats sont les suivants :
| Inscrits | OUI | NON | |
|---|---|---|---|
| France entière | 3 500 000 | 8 374 | |
| Département de Seine et Oise | 94 570 | 24 482 | 27 |
| Commune de Villennes | 80 | 17 |
Si le vote "oui" représente un vote conservateur, l’opposition de gauche s’exprime faiblement mais le nombre des abstentions est important ; cela est également le fait du mode de scrutin.
Le sénatus-consulte qui proclame Napoléon Bonaparte, Consul à vie, donne lieu à des cérémonies et à des fêtes dans certaines communes du département : en particulier à Poissy, le 27 thermidor An X (15 août 1802), avec défilé de la Garde Nationale et proclamations en différents points de la ville, Te Deum et, le soir, illumination générale. D’autres communes envoient des lettres de satisfaction ; rien de tel pour Villennes qui ne semble pas s’être manifestée.
La nouvelle constitution
Le 16 thermidor An X (4 août 1802), un sénatus-consulte institue la Constitution de l’An X, qui est une adaptation de la constitution de l’An VIII au consulat à vie.
Le même sénatus-consulte réforme le système électoral : le suffrage universel subsiste dans les assemblées cantonales. Encore faut-il se rendre à ces dernières, dont les présidents, l’ordre du jour et même la composition sont soumis à la volonté gouvernementale ; leurs seules missions sont de choisir les conseillers municipaux des petites communes et surtout de sélectionner parmi les 600 plus imposés du département les 200 à 300 électeurs de département, qui représentent seuls les candidats aux fonctions législatives nationales ou aux conseils généraux de département. Le suffrage censitaire est donc rétabli et il en sera ainsi jusqu’en 1848.
Les membres des conseils municipaux sont choisis par chaque assemblée de canton sur la liste des cent plus imposés du canton, arrêtée et imprimée par ordre du préfet ; ils sont renouvelables tous les dix ans par moitié.
Le Premier Consul et les préfets choisissent les maires et les adjoints dans les conseils municipaux ; en place pour cinq ans, ils peuvent être renommés.
Dans l’immédiat, ceci ne provoque pas de changement à Villennes, dont Henry Le Large reste le maire.
La conscription
Un des aspects les plus désagréables de la fonction de maire est la conscription : il est, en effet, responsable des réfractaires et des insoumis de sa commune. Or poursuivre ces délinquants l’expose à l’hostilité de ses administrés et de nombreux maires seront destitués pour avoir omis de les signaler à la gendarmerie.
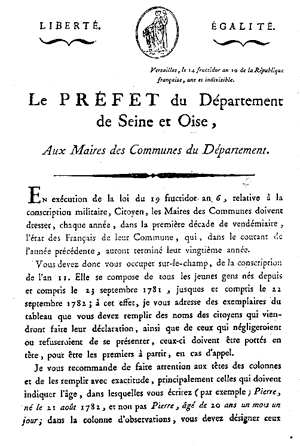 |
Voici comment se passe cette démarche en brumaire de l’An X (novembre 1802), "en exécution de l’arrêté des Consuls, de thermidor an X, relatif à une levée des conscrits des années IX et X, tant pour entrer dans les cadres de l’armée d’active que de l’armée de réserve" : Les maires des communes d’Orgeval, de Villennes et Morainvilliers se réunissent en conseil, avec une délégation de conseillers municipaux de chaque commune, sous la présidence du maire d’Orgeval. Conformément à l’article 5 du susdit arrêté, le conseil qui a le choix du mode de désignation des conscrits, décide à l’unanimité de procéder par le sort. On établit alors, pour chaque commune, la liste des jeunes gens susceptibles d’être appelés au service. |
Pour l’An IX, il y en a 12 pour Orgeval, 4 pour Villennes et 1 pour Morainvilliers ; pour l’An X, 12 pour Orgeval, 1 pour Villennes et 2 pour Morainvilliers.
On procède au tirage au sort pour l’An IX : on fait 17 morceaux de papier d’égale grandeur dont 3 portent la mention "Conscrit de l’An IX devant faire partie de l’armée d’active" ; on met le tout dans un chapeau et le président fait appel aux conscrits qui viennent tirer chacun leur tour.
Résultat : 2 jeunes gens d’Orgeval et 1 de Villennes sont désignés pour faire partie de l’armée d’active pour le contingent de l’An IX.
On procède de la même manière pour la réserve de l’An IX : 2 pour Orgeval, 1 pour Villennes. Les mêmes opérations recommencent pour l’An X : 3 d’Orgeval pour l’armée d’active, 2 de Villennes et 1 de Morainvilliers pour la réserve.
Le président déclare, ensuite, aux conscrits ainsi désignés tant pour l’armée d’active que pour l’armée de réserve, que le conseil leur accorde 3 jours pour se faire substituer s’ils le désirent.
Telle est l’origine de nos conseils de révision et du fameux tirage au sort. La conscription est donc pour le moment raisonnable puisque 6 jeunes gens seulement sont pris chaque année pour l’ensemble des 3 communes, dont 3 pour l’armée d’active. De plus, ils ont la possibilité de se faire remplacer depuis le 18 mai 1802 par l’achat d’un remplaçant, cette disposition n’étant que tolérée auparavant.
La durée du service est de 5 ans et concerne tous les français de 20 à 25 ans ; alors que la levée libérait immédiatement les jeunes gens non désignés par le sort, avec la conscription on peut être enrôlé tant que la 26e année n’est pas atteinte.
Après le Concordat : devis des réparations de l’église
de Villennes et organisation de son fonctionnement
Après de longues négociations avec Rome, le concordat est adopté par le corps législatif le 6 avril 1802. Trois jours après, le légat du pape est reçu officiellement ; la promulgation solennelle a lieu à Notre Dame de Paris, le dimanche 18 avril, jour de Pâques.
Ce Concordat entre l’Etat français et l’Eglise catholique durera un siècle.
L’Eglise de France se trouve alors en état de dénuement : églises dévastées par les saccages et par le manque d’entretien, cloches fondues, mobilier détruit, objets liturgiques réduits à néant. Si le concordat est censé mettre fin à cet état de fait, il met aussi l’Eglise sous contrôle étatique, à tel point que même la sonnerie des cloches (celles qui restent) est réglementée. Le 6 juillet 1802, le préfet de Seine et Oise expédie une affiche aux communes, précisant :
Le Diocèse de Versailles n’étant pas encore organisé, il se doit de publier un règlement sur la manière d’appeler les fidèles au Service Divin par le son des cloches mais comme il pourrait survenir des troubles à cet égard j’ai pensé qu’il serait à propos d’adopter provisoirement pour mon Diocèse les mesures prescrites dans le règlement que Monsieur l’Archevêque de Paris vient de publier.
En fait seul l’Angélus, sonnerie appelant à l’office et célébration de certaines fêtes religieuses est autorisé, toutes autres sonneries étant interdites.
Au cours de l’année 1803, les préfets font un inventaire des travaux à exécuter dans les églises de leur département ; ainsi le 28 mars, le préfet de Seine et Oise adresse une lettre dans ce sens au conseil municipal de Villennes, qui l'enjoint de faire dresser l’état des réparations à faire à l’église de la paroisse. Si celle-ci n’a pas été saccagée, son état n’en est pas pour autant florissant car comme beaucoup elle est restée plus de dix ans sans travaux. Sur convocation du maire, des artisans établissent des devis de réparations
Le conseil a invité le citoyen Laurent Ollivon, maçon patenté, de se rendre en notre église afin de dresser l’état des réparations à faire en maçonnerie, qui a reçu 9 francs, a aussi invité le citoyen Fertille, vitrier et peintre patenté de dresser l’état des réparations à faire aux croisées de la dite église, il a reçu 5 francs.
Le conseil municipal délibère ensuite en la maison commune, le 10 floréal An XI de la République Française (30 avril 1803), et arrive à cette conclusion :
Vu les deux états annexés au présent procès verbal, le montant ensemble s’élève à la somme de 424,45 Frs, aucun des membres n’apercevant de moyen à y pourvoir, tous d’un commun accord, autre de délibérer à demander au préfet l’imposition de cinq centimes pour franc sur les contributions foncières personnelles et mobilières de l’an XI, seulement pour subvenir aux dites dépenses les plus urgentes.
Le préfet, après s’être préoccupé de l’état des églises, demande aux communes d'organiser leur fonctionnement ; ainsi le 6 floréal de l’An XI (26 avril 1803), il adresse une lettre à la municipalité de Villennes, demandant que le conseil délibère "sur les augmentations de traitement à accorder sur les ressources de la commune" :
- Au curé
- Sur les frais d’ameublement des maisons curiales
- Sur les frais d’achat et d’entretien de tous les objets nécessaires au service du culte.
Le conseil municipal décide que pour répondre à ces demandes, voyant que les revenus n’étaient pas même suffisants pour subvenir aux dépenses communales, d’après toutes les recherches possibles, qu’il ne voyait d’autres ressources que de demander la réimposition sur les contributions foncières personnelles et mobilières :
- Pour le traitement du succursale, 5 centimes pour franc
- Pour les frais d’ameublement de la maison curiale, 1 centime pour franc
- Pour les frais d’achat, entretien de tous les objets nécessaires au service du culte, 2 centimes pour franc.
Les membres du conseil n’apercevant pas d’autres moyens que ceux ci-dessus présentés, se soumettent à la sagesse du gouvernement et se persuadent d’en avoir satisfaction.
C’est ensuite au conseil municipal de se préoccuper de l’administration de l’église et le 25 floréal An XI (15 mai 1803), le Conseil délibère qu’il serait nommé deux administrateurs afin de surveiller aux intérêts et au bon ordre de notre église de Villennes, qu’ils seraient renouvelés par moitié tous les ans. A cet effet le maire ayant assisté à la grande messe le 20 du mois, jour de l’Ascension, a nommé au nom du conseil municipal, le citoyen Charles Thuillier pour premier administrateur et Jean Duteil pour second. Ils commenceront leur mission le 9 prairial (29 mai 1803) jour de la Pentecôte et le premier qui la finira est Charles Thuillier, le jour de la Pentecôte de l’An XII, les autres ainsi de suite.
Pour ce ils se muniront d’un registre pour inscrire leurs recettes et dépenses et ce qui sera nécessaire. Les dits administrateurs ne pourront faire aucune dépense qui excédera 10 francs, sans une autorisation du conseil municipal; les particuliers qui vendront le pain bénit pourront quêter en rendant le produit de leur quête, qui de suite sera inscrit en leur présence par un administrateur, de suite après la messe; lorsqu’il n’y aura pas de pain bénit, la quête sera faite par un des administrateurs ou pourront commettre quelqu’un à leur lieu et place.
Et lorsque le tour d’un des administrateurs sera fini, il rendra son compte à ses successeurs qui lui en donneront décharge en présence du Maire et de deux membres du conseil dans le mois qui suivra la fin de son exercice.
Maintien du maire de Villennes, avec de nouvelles attributions
Le 3 germinal de l’An XI (24 mars 1803), le gouvernement prend le décret suivant : les maires et les adjoints, qui sont actuellement en fonction, cesseront de droit de l’exercer en l’An XV ; ils seront rééligibles.
Ceux nommés à cette époque resteront en place jusqu’en l’An XX, seront renouvelés ainsi de 5 ans en 5 ans et pourront être renommés.
La nomination est faite par le préfet conformément à l’article XX de la loi du 28 pluviôse de l’An VIII.
A Villennes, Henry Le Large et Benoît Rédaux sont maintenus en fonction.
Le 10 messidor de l’An XI (29 juin 1803), le préfet procède à un tirage au sort pour désigner les cinq membres du conseil municipal à renouveler : Menard Laurent, Souhard Jean Baptiste, Chevalier Pierre, Giraux Nicolas, Duteil Mathieu.
Le préfet de Seine et Oise, Germain Garnier, rappelle aux maires la nouvelle organisation de l’administration municipale :
- Ils sont chargés de l’état civil et il leur appartient de procéder à la célébration des mariages dans leur commune ;
- Ils recevront en conséquence un registre destiné à constater ceux-ci, conformément à l’article 3 de la loi du 13 fructidor An VII, qui n’est point abrogée ;
- La célébration des mariages ne devra toujours avoir lieu que le jour de décadi.
Le premier différend entre Villennes et Médan, à propos de l'hospice
La maison d’hospice tenue par les deux sœurs de Nevers est l'objet d'un litige entre les deux communes voisines : le maire de Médan demande la liquidation de la rente de 720 francs laissée par le testament de Mme de Cotte, mère de Pierre Gilbert de Voisins, le 27 septembre 1777, pour le fonctionnement de cette maison. Par un courrier du 8 avril 1803, le Sieur Dessagnes du Bureau des commissions et des recettes des rentes et pensions constate que les communes de Villennes et de Médan sont propriétaires d’une créance sur l’Etat pour une somme de 720 francs, et promet de se charger de la liquidation de cette rente si les deux communes lui en donnent pouvoir.
Le 17 avril, le conseil municipal de Médan se rend à Villennes afin d’obtenir l’accord de son homologue. Son registre des délibérations nous rend compte de cette entrevue :
La lettre dont les renseignements ci-dessus furent pris, fut portée à Villennes le 27 germinal An XI (17 avril 1803) sur les 7 heures du matin par le Maire de Médan accompagné par des membres du conseil municipal qui la remirent au Maire de Villennes en la maison commune où il était accompagné de son conseil municipal, le Maire de Villennes refusa de signer sur ces registres comme il est dit d’autre part, la remise de la lettre. Les propos qui furent lâchés ont démontré jusqu’à l’évidence que Villennes voyait avec peine que Médan eut connaissance de la disposition du testament et du legs ci-mentionné de l’autre part que son intention prouvée par sa conduite était d’exclure Médan de la part et portion qu’il avait au testament.
Cette entrevue s’étant mal terminée, le maire de Médan persiste en écrivant au Sieur Dessagnes pour lui demander, en son nom et au nom de Villennes, quelles sont les pièces à produire pour parvenir à la liquidation de la rente. Il lui est répondu que les pièces nécessaires sont :
- Les grosses des deux contrats ;
- Une procuration ;
- Un certificat du préfet constatant que les maires des deux communes sont les seuls administrateurs des biens des pauvres des deux communes ;
- Une déclaration prescrite par la loi du 12 brumaire de l’An VII.
Le maire de Médan cherche toujours à se procurer une copie du testament de Mme de Cotte, veuve de Pierre Paul Gilbert de Voisins :
Il apparaît qu’il est probable que les titres nouveaux de la rente portée au sus dit testament nouvel ont du être expédiés aux deux communes par le Sieur Boulard, notaire de la famille Gilbert de Voisins et que c’est dans son étude que le dit testament fut déposé.
Jusqu’à ce jour la commune de Médan, en vertu des renseignements ci-dessus, cherchait avec ardeur à se procurer la copie du testament de Mme de Cotte veuve de M. Gilbert de Voisins, elle savait que la nommée Laroque la ci-devant sœur de la communauté de Nevers et actuellement exerçant la chirurgie dans le bâtiment légué à Villennes, était en possession de cette copie, que le Maire de Villennes devait aussi en avoir une dans ses archives. On fit donc une démarche à Villennes auprès de l’une et de l’autre. Mais le caractère bizarre et un peu extraordinaire de la dite Laroque et une politique mal placée ou peut-être même un défaut de connaissance suffisante ou une rivalité mal entendue du Maire de Villennes, rendirent la démarche de Médan inutile, on reçut même des invectives, il y eut de faux rapports des faits à Mme de Voisins et M. d’Osmond, petit-fils de la testatrice en leur faisant entendre que Médan cherchait à s’approprier à lui seul la rente de la fondation, ils le crurent mais sans fondement, Médan plus éclairé et moins jaloux que Villennes était bien loin de commettre une pareille ineptie, son seul désir comme on le verra dans la lettre écrite au Sieur Dessagnes le 18 avril était d’avoir tous les renseignements possibles afin que de concert avec Villennes on put hâter la liquidation de la rente. Les renseignements que le dit Dessaisir renvoya au Maire de Médan en lui écrivant le 2 floréal ainsi qu’il est mentionné démontrent cette vérité, qui n’a besoin de preuve, que pour des maladroits semblables à ceux dont a Villennes ou suivant les conseils de la dite Laroque qui continue toujours à indisposer le maire de la commune, M. et Mme de Voisins d’Osmond contre Médan, ils ajoutèrent si extraordinairement foi aux propos absurdes de cette fille, qu’ils avancèrent cette impudente assertion qu’eux-mêmes allaient s’emparer de la fondation si Médan persistait dans son intention de tout avoir, et c’était le vœu bien prononcé de la dite Laroque. Mais enfin à force de chercher on trouva dans le coffre de la fabrique de Médan, le 1er mai après la grande messe, la copie littérale du testament et afin qu’on put la trouver au besoin.
La réaction de la famille Gilbert de Voisins, faisant savoir qu’elle fera valoir ses droits d’héritiers, calme un certain temps les esprits. De plus, la maison d’hospice, qui a traversé la période révolutionnaire, cesse son activité ; le caractère fantasque de la sœur Laroque ne doit pas être étranger à cet état de fait, la sœur Melon, chargée de l’éducation, étant déjà partie suite à un différend qui l’opposait à celle-ci.
Les nouveaux impôts
Les régimes passent mais les impôts restent. Alors que la Déclaration des droits de l’homme précise que "La contribution commune est indispensable", la constitution de l’époque déclare : "Nul citoyen n’est dispensé de l’honorable obligation de contribuer aux charges publiques".
Les anciens impôts supprimés sont remplacés par un système, qui va durer jusqu’en 1914. Celui-ci est fondé sur trois contributions :
- La contribution foncière touche les propriétés foncières, les terres, à proportion de la surface possédée ;
- La contribution mobilière concerne les revenus autres que ceux issus de la terre et du commerce, principalement les rentes et les bénéfices industriels ; elle est fondée sur les signes extérieurs de richesse, les loyers, le nombre de domestiques ;
- Les bénéfices commerciaux sont relatifs aux patentes.
En novembre 1798, une quatrième contribution est créée, taxant les portes et les fenêtres. Les impôts indirects, qui avaient été supprimés en raison de leur impopularité, sont discrètement réintroduits : droits d’enregistrement des actes notariés, droit de timbre, droit sur le tabac.
Villennes n’échappe pas à toutes ces contributions : suite à une lettre du préfet du 20 prairial An XI (9 juin 1803), demandant au conseil municipal de nommer un nouveau percepteur pour pourvoir à la perception des contributions directes de l’An XII, celui-ci prend la délibération suivante :
Considérant qu’il pourrait se glisser quelques abus par l’adjudication, les membres du conseil réunis ont délibéré à en nommer un d’office, ont nommé le citoyen Pierre Fournier, cultivateur dans la dite commune pour percepteur d’office moyennant la remise de 4 centimes pour franc du montant du principal et des centimes additionnels tant des contributions foncières personnelles somptuaires et mobilières que celles des portes et des fenêtres et des patentes de l’An XII.
A la charge pour le dit citoyen Fournier :
- de fournir au receveur particulier dans le courant de 10 jours et dans la forme prescrite par l’article 7 de l’arrêté des Consuls du 16 thermidor de l’An VIII, un cautionnement en immeuble, dont la valeur libre sera du quart au moins du montant du rôle de la contribution foncière.
- de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à la perception dont il s’agit.
- de faire gratis conformément à l’article 39 de la loi du 11 frimaire An VIII la recette des revenus communaux autres que ceux provenant des centimes additionnels.
- et de rendre compte de ces recettes et dépenses communales dans le courant de vendémiaire (septembre - octobre) de l’année suivante ainsi qu’il est prescrit par l’article 51 de la dite loi du 11 frimaire.
Lequel citoyen Pierre Fournier appelé et ici présent, après avoir pris connaissance des charges, clauses et conditions ci-dessus énoncées, a accepté sa nomination avec promesse de s’y conformer et a signé.
Le citoyen Pierre Fournier sera le dernier percepteur élu ou désigné par la municipalité à percevoir la totalité des impôts de la commune, la mainmise et la centralisation de l’état se poursuivant avec la création de l’administration des Droits Réunis, qui rassemble tous les impôts indirects, ainsi que la nomination de percepteurs fonctionnaires de l’état.
Le retour de tous les émigrés, y compris la famille Gilbert de Voisins
Pour calmer les insurrections intérieures, le Premier Consul décide, dès 1800 et principalement en 1801, de radier des listes des émigrés un nombre de plus en plus important de ceux-ci. Lassés par dix ans d’émigration souvent miséreuse, les émigrés reviennent par milliers quand ils constatent que tout danger est passé. A peine rentrés, ils font le siège des gens en place pour se faire restituer leurs biens non encore vendus.
|
Anne Marie de Merle, la veuve du dernier seigneur de Villennes, Pierre Gilbert de Voisins rentre en France à la fin de l’an 1800, ainsi que ses enfants ; elle décède quelques mois plus tard, le 17 avril 1801 à Paris. La lettre reproduite ci-contre prononce, le 19 messidor de l’An IX (8 juillet 1801), la radiation définitive de la liste des émigrés pour elle et ses héritiers : ceux-ci peuvent rentrer dans la jouissance de leurs biens dont la vente a été suspendue dès le 12 frimaire de l’An IX (3 décembre 1800). Le jeune comte Pierre Paul Alexandre Gilbert de Voisins réside à Paris et sa sœur Anne Marie, mariée au vicomte Charles Marie Eustache d’Osmond, vient s’installer à Villennes dans le château (l’ancien château des Perdrier-Brinon) qui leur a été restitué. Le trouvant dans un état délabré, ils vont commencer la transformation des communs, pour en faire le château de Villennes qui subsistera jusqu’au début du XXe siècle. |
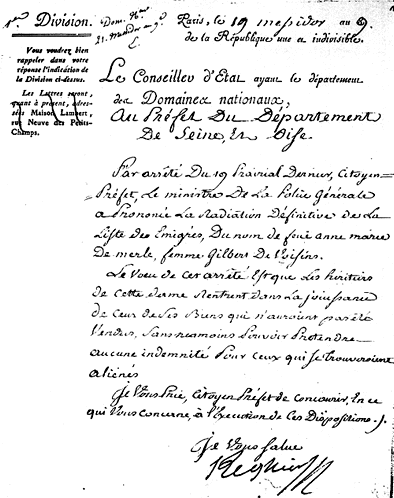 |
Napoléon fera tout pour que la noblesse s’intègre à sa propre noblesse, certainement pour donner un vernis à celle-ci. Devenu empereur, il aura pour chambellans les grands noms de la noblesse passée de Versailles aux Tuileries ; les uns iront au Sénat et les autres, surtout les plus jeunes, feront une carrière des armes. Presque tous trahiront l’Empereur pour Louis XVIII, témoignant au vaincu un mépris d’autant plus hautain qu’ils ont davantage rampé au retour de l’émigration.
De 1804 à 1815 : l'Empire
Napoléon Bonaparte devient l'Empereur des Français
Si la paix a été à l’origine de la constitution de l’An X, la guerre provoque tout autant celle de l’An XII. Le 20 mars 1804, le Sénat vote une motion de Fouché qui invite Napoléon Bonaparte à achever son ouvrage en le rendant immortel comme sa gloire. Le Tribunat, sauf Lazare Carnot, et le Sénat décident de confier le gouvernement de la République à un empereur héréditaire.
Pour la forme, un nouveau référendum est organisé pendant douze jours à partir du 28 floréal (18 mai 1804) ; la "question" soumise aux français est celle-ci :
Le peuple veut l’hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu’il est réglé par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal An XII.
Le résultat de cette consultation dans le département de Seine et Oise est le suivant :
| Inscrits | environ 95 000 |
| Oui | 52 766 |
| Non | 9 |
On doit toutefois remarquer que le nombre de oui est double de celui du référendum sur le consulat à vie pour un mode de scrutin identique. Si on ignore le résultat de Villennes, à Médan le registre des délibérations indique qu’il y eut 10 oui et aucun non.
Cette Constitution de l’An XII est adoptée par le Sénat le même jour que le début du référendum sur l’hérédité, c’est à dire le 18 mai 1804, et il y est dit dans son premier article :
Le Gouvernement de la République est confié à un empereur, qui prend
le titre d’Empereur des Français.
La Justice se rend au nom de l’Empereur.
Napoléon Bonaparte, Premier Consul actuel de la République, est
Empereur des Français.
 |
Un décret du préfet du 12 floréal An XII (1er juin 1804) demande aux municipalités le serment d’obéissance aux Constitutions de l’Empire et de fidélité à l’Empereur. Celui-ci est prêté à Médan le 5 messidor An XII (24 juin 1804), mais il n'y a pas de trace de ce serment pour Villennes. |
Second différend entre Villennes et Médan,
à propos de la nomination d'un percepteur commun
Après le calme qui a suivi le premier différend, le conseil municipal de Médan, un an plus tard, est toujours aussi vindicatif. Cette fois, il épingle son propre maire, pour avoir signé une pétition sans en avertir le conseil municipal pour la nomination de François Simon de Villennes, comme percepteur des deux communes :
Il apparaît par la demande que le sieur François Simon, rentier, domicilié au château de Villennes a faite le 27 germinal An XII ( 17 avril 1804), qu’on eut à envoyer son nom et prénom ainsi que son domicile et qualités au sieur Fournier, chef du bureau des impositions à la préfecture de Seine et Oise à l’effet de le faire nommer percepteur des contributions des deux communes, Villennes et Médan, et à vie, que le sieur d’Osmond, propriétaire du dit château de Villennes a fait une pétition directe au préfet en faveur du dit Simon pour la fonction susdite, que cette pétition a été signée par le sieur Lelarge, Maire de Villennes, et par le sieur François Rouleau, Maire de Médan dans le mois de ventôse dernier (février-mars) sans avoir consulté auparavant la commune. On voit par le silence mis dans cette opération que l’alliance et la parenté, entre les deux maires, et le dit Simon avec le dit d’Osmond dans son château, en ont été le motif et si la commune de Médan n’y prend garde, après avoir signé la réunion de la perception des deux communes on signera de même en décret la réunion de l’administration des deux communes et bientôt enfin la réunion totale de la commune de Médan à celle de Villennes. C’est à quoi tend cette première demande du sieur d’Osmond et de plus cette fine politique avec laquelle il conduit adroitement à des fins les projets qu’il conçoit, il est d’ailleurs protégé et ami des Ministres des Finances et de l’Intérieur et des plus grands à la tête des affaires, c’est plus qu’il en faut pour faire disparaître la commune de Médan s'il l’entreprend.
Troisième différend entre Villennes et Médan,
à propos de la réunion des deux paroisses
L’organisation des diocèses est la même que l’organisation administrative des départements. Dans le département de Seine et Oise, si la volonté est de vouloir rouvrir toutes les églises, il faut bien tenir compte de la pénurie de prêtres après huit ans de non-recrutement : sur trente mille prêtres recensés, un tiers ont plus de soixante ans. Devant cette situation, sur les 600 paroisses que compte le département, seulement 450 églises ont été à nouveau ouvertes.
Poissy devient le siège de la cure, les églises des autres paroisses du canton étant des succursales. A la demande du préfet, le conseil municipal de notre commune, délibère sur la question du regroupement de paroisses, qui se pose notamment entre Villennes et Médan :
Les membres du conseil municipal de la commune de Villennes, et le succursaire (prêtre) de la dite commune, réunis en leur maison commune, ont délibéré sur la dite question.
1° - Qu’il y avait lieu à conserver leur succursale, vu qu’elle est éloignée d’une lieue des fortes communes telles que sont celles de Poissy, Orgeval et de Vernouillet.
2° - Qu’il y a lieu de réunir la commune de Médan à celle de Villennes, attendu que la dite commune de Médan, n’est pas éloignée de plus d’un quart de lieue de distance de celle de Villennes et que la population est pour le moins moitié moindre que celle du dit Villennes, presque tous les habitants de Villennes ont des propriétés sur la commune de Médan, ce qui fait qu’il semblerait faire qu’un même territoire et de plus les habitants de Médan ayant l’avantage d’avoir part aux bienfaits d’une fondation faite d’une maison servant d’hospice et d’éducation située à Villennes.
Cette délibération est signée par tout le conseil municipal de Villennes et par le nouveau desservant, Philippe Sudre. On peut facilement imaginer que cette décision ne reçoit pas l'approbation de la commune de Médan.
Son conseil municipal, qui a reçu du préfet la même lettre que celui de Villennes, pour le regroupement des succursales, ne tarde pas à faire connaître sa position :
Ce jourd’hui 17 thermidor An XII (5 août 1804), le conseil municipal de la commune convoqué par le maire du lieu en vertu de la circulaire de M. le Conseiller d’Etat, préfet du département de Seine et Oise à l’effet de la réunion ou conservation des succursales appelle à la délibération suivante : il y a lieu à conserver la succursale de Médan - motifs de la conservation tirés de la nature des choses mêmes.
1° - La solidité et la beauté de son église construite en pierres de taille polies et unies, la face flanquée de deux superbes tours en forme du Dôme des Invalides et également toutes deux en pierres polies et unies comme le corps de l’église, sans presque besoin d’entretien, chef-d'œuvre de l’art admiré de tous les connaisseurs et digne de faire l’ornement des plus belles rues de la capitale. Elle fut bâtie en 1636 par messire Jean Bourdin, son illustre fondateur et alors seigneur de l’endroit et des environs, son zèle et ses moyens ne lui firent rien épargner pour la rendre belle et durable, sa dot seule a disparu dans l’orage.
2° - Un presbytère également construit par le même, attenant à l’église et un jardin, rare et puissant secours pour une succursale et motif déterminant pour la conserver comme venant en décharge d’autant pour les habitants.
3° - Augmentation légale et facile de population. Celle de Médan n’est pas nombreuse à la vérité, cinquante feux, deux cent douze individus, mais sans faire tort aux voisins et en rendant à Médan la justice qu’elle est en droit de réclamer, le conseil municipal expose qu’on peut élever cette population aux taux propres à conserver la succursale. Il y a un hameau qui s’appelle Breteuil, dépendant en partie de Médan et en partie à Villennes. La totalité de ce hameau appartenait autrefois à Médan, la suppression des fiefs d’alors le divisèrent et en réunit la plus grande partie à Villennes. Médan demande la restitution de cette distraction qu’elle tolérait alors, mais que les circonstances présentes annulent et réprouvent surtout par la circulaire de M. le Conseiller d’Etat qui ne veut aucun morcellement. En remettant les choses dans leur premier état, la population de Médan dépasse alors quatre cents individus et son territoire augmente d’un tiers. Ses voisins n’ont donc plus alors à s’enorgueillir d’un vol qui fait toute leur force, car ce hameau rendu à sa destination, Médan reprend sa véritable place et anéantit pour toujours les prétentions de Villennes sur lequel il l’emporte sous tous les rapports. Qu’on joigne à cela le vœu bien prononcé de tout le dit hameau qui, en 1789 où pareille question s’agita, demanda unanimement, comme il le fait encore, sa réunion à Médan. Et que deux raisons l’y déterminent : plus près de Médan que de Villennes d’un quart d’heure, chemin facile et droit, au lieu que la sente qui le conduit à Villennes qui est souvent impraticable, dangereuse même, par une pente de près de quatre cents toises dure et longue, aux flancs d’une montagne presque à pic au bas de laquelle se trouve cette commune et ce n’est pas une nouveauté d’apprendre que, pour se rendre à son église, plusieurs ont roulé du haut de la montagne dans des précipices où les uns se sont estropiés et d’autres ont péri. Voila des faits qu’on ne peut révoquer, de là sans doute la raison pour laquelle en tout temps ce hameau vient exercer son culte à Médan où il veut aujourd’hui se réunir pour toujours.
Et où voudrait-on réunir Breteuil ? A Villennes, comme plus proche !
Mais l’horrible situation de ce pays que la nature a, ce semble, voulu faire cadrer avec le nom, en dégoûte. Les chemins qui y conduisent sont véritablement impraticables en hiver. Son église menace ruine, son clocher déjà tremblant, s’agite et chancelle. Son intérieur est pourri. Il est un fait qu’une personne bien mise ne peut s’asseoir dans ce temple où tout ressuinte une eau noire et fétide, qui jette une telle humidité que les reptiles et crapauds s’y engendrent et que par le malheur des temps ils semblent prendre la place des catholiques qui l’abandonnent. Cette église d’ailleurs remplie de piliers n’offre pas plus de places que Médan et sa distance de trois quarts d’heure de chemin, toutes choses égales, anéantirait la religion dans les cœurs les plus zélés.
4° - Médan pour toutes ces raisons et d’autres majeures, fussent dans la morale, l’habitude, le goût, les intérêts spirituels et temporels des habitants qui se veulent sans besoin d’explication, le conseil municipal de Médan vote pour la conservation de sa succursale à cet effet il offre de prendre tous les moyens de pourvoir, chez lui, aux frais du culte et aux honoraires du ministre par un acte qui sera soumis à la ratification de qui de droit.
La commune de Vernouillet, dont l’église a été rendue au culte, n'est pas épargnée par la diatribe du maire de Médan. Finalement cette nouvelle querelle se termine bien, la paroisse de Médan se voyant pourvue d’un prêtre, son église étant rendue au culte ; malheureusement sept mois plus tard, le 5 mars 1805, le prêtre quitte Médan, car il n'est pas payé.
Les héritiers des seigneurs revendiquent la propriété
de voies communales
Un premier différend oppose la famille d'Osmond-Gilbert de Voisins, d’une part, et les sieurs Simon, Philippe Lamiraux et la veuve Luc Gaury, d’autre part. Le conseil municipal, en l’absence du maire et de l’adjoint, se réunit sur ordre du préfet, le 19 août 1804 :
Afin de délibérer sur le fait des actes de propriété et de jouissance exercés par ces trois personnes, ceux-ci mandés comme détenteurs des territoires annoncés formant place publique et chemin dépendant de la commune à l’effet de leur demander l’exhibition des lettres sur lesquelles ils entendaient établir leurs droits de jouissance, ont de concert répondu en signe, à l’exception de la veuve Gaury laquelle a déclaré ne le savoir, que les héritages dont ils jouissaient ne leur appartenaient point, qu’ils étaient la propriété de Pierre Paul Gilbert de Voisins et de Anne Marie Marthe Gilbert de Voisins sa sœur, la dite Dame épouse du sieur Osmond, domicilié à Villennes, qu’ils tiennent d’eux à titre de location sans bail ; que sous ce rapport, ils ne pouvaient répondre à la dite question de propriété de ces héritages; que dans tous les cas et avant tout, ils pensaient que le conseil n’avait point à s’occuper de demander à ceux-là qui jouissent et qui ont pour eux la propriété en possession, des justifications de propriété, mais bien d’examiner si la commune avait des titres de propriété des héritages énoncés dans les sommations, qu’au surplus ils faisaient réserves de leurs droits et de ceux de leurs propriétaires auxquels ils n’entendaient pas déroger par leur comparution, même de se pourvoir en complainte et maintiendront contre ils aviseront, et de répéter toutes pertes et dépenses.
La dite réponse prise comme orgueilleuse, présumée dictée par les sieurs et dame Gilbert de Voisins, femme d’Osmond ci-devant seigneur.
Le conseil municipal de la commune de Villennes, délibérant d’après les lettres patentes du Roy sur un décret de l’Assemblée Nationale du 26 juillet 1790, relatif aux droits de propriété et voyerie sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes et d’après l’article premier qui dit expressément : "Le régime féodal et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourra dorénavant à l’un ou à l’autre de ces titres prétendre à aucun droit de propriété ni de voyerie sur les chemins publics, rues et places de villages bourgs ou villes".
Délibérant encore d’après la loi du 28 août 1792 qui dit "que les terres et vagues dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en leur possession sont censés leur appartenir".
Est à l’unanimité demeure d’avis que la commune de Villennes, a droit de réclamer sur les sieurs Gilbert de Voisins et dame d’Osmond sa sœur, les terrains que mal à propos ils ont loués sans bail aux sieurs Simon, Philippe Lamiraux et veuve Gaury parce que si réellement ils les eussent eus, comme ils le prétendent, feu Gilbert de Voisins leur père, n’aurait pas manqué de les enclaver dans ses murs. Les terrains dont jouit la veuve Gaury et celui qu’occupe le sieur Simon qui tous deux tiennent aux murs de leur parc, pour le prouver le terrain du dit sieur Simon qui est entre les murs du dit parc et celui du cimetière de la dite commune, était fermé du vivant de Mr. Gilbert de Voisins leur père, par une grande porte qui a été que depuis la Révolution enclos de murs aux deux extrémités par Mr d’Osmond afin d’interdire le chemin qui conduit au moulin à eau lequel en est voisin.
Pourquoi d’après et sur les renseignements par lui pris, le conseil municipal en réfère à vous, M. le préfet et vous invite pour l’intérêt de la commune et de ses habitants de régler les prétentions que mal à propos le sieur Gilbert de Voisins et dame d’Osmond ont élevées sur ces terrains dont ont jamais joui leurs auteurs, que par leur prétendu droit féodal.
Cette affaire semble assez nébuleuse, les droits de chacune des parties étant aussi contestables.
Ce conflit ne sera pas le dernier : de nombreux autres litiges opposeront encore la famille d'Osmond-Gilbert de Voisins à la commune ainsi qu’à l’Etat, lorsqu'elle tentera de rentrer en possession de ses biens.
Les premiers comptes communaux
Un arrêté du gouvernement du 4 thermidor de l’An X (23 juillet 1802) oblige les communes à établir un budget et à présenter leurs comptes, mais il faut attendre le 10 germinal de l’An XIII (31 mars 1805) pour trouver trace de ces comptes à Villennes.
Voici la première présentation des comptes de l’An XII (1803-1804), faite par le maire devant le conseil municipal :
Comptes de l’An XII (1803-1804)
| Chapitre Premier: Recettes | |
|---|---|
| Sommes perçues en l’An XII sur l’arriéré | 174,31 |
| Somme des cinq centimes additionnels sur les contributions foncières et mobilières | 330,87 |
| Rétribution sur le dixième du produit des patentes | 8,30 |
| Amendes de police | 6,00 |
| Biens ruraux, communaux, prix du bail ou de l’adjudication | 50,00 |
| Total | 569,48 |
| Chapitre Deux: Dépenses | |
|---|---|
| Payement des dépenses et des dettes anciennes exigibles sur les exercices précédents | 32,23 |
| Abonnement au bulletin des lois | 6,00 |
| Frais de registre de l’état civil | 15,24 |
| Réparations ou loyer du presbytère | 120,00 |
| Frais d’objets servant au culte | 60,00 |
| Soin et lumière, encre, papier, plumes et frais de toute espèce alloués au maire | 50,00 |
| Traitement du messager de l’arrondissement | 30,22 |
| Frais de prison de la justice de paix | 9,48 |
| Entretien des puits et des fontaines | 30,00 |
| Visite des feux et cheminées | 10,00 |
| Entretien et conduite de l’horloge | 50,00 |
| Total | 413,17 |
Balance
Recettes : 569,48
Dépenses : 413,17Il résulte que le percepteur de l’An XII se trouve recalicataire de la somme de 156,31 Frs. Sur quoi le conseil municipal a délibéré de faire la demande à Mr. le préfet pour l’autoriser à employer cette somme à la réparation de la couverture de notre église et de la maison d’hospice qui sert en partie de mairie.
On constate que la commune de Villennes, comme d’ailleurs la plus grande partie des communes rurales, est une collectivité pauvre, qui n’a point de ressources ; elles ne peuvent qu’emprunter et gérer au mieux les propriétés communales, quand elles en possèdent, ou bien les vendre, ou encore voter des impôts supplémentaires (centimes additionnels) mais au risque de se rendre impopulaires.
Guerre et paix
Depuis le 18 mai 1804, date de la création de l’Empire, et le 2 décembre, jour du sacre de Napoléon Ier, la France qui était en paix depuis le traité d’Amiens, est de nouveau en conflit face à une coalition composée de la Russie, de l’Autriche, de la Suède et du royaume de Naples.
Pendant toute la deuxième partie de l’année 1805, Napoléon se trouve hors de France. En septembre, il envahit l’Allemagne ; c’est la victoire d’Ulm sur les Autrichiens, mais le lendemain la flotte française est détruite par Nelson à Trafalgar. En novembre, c’est l’occupation de Vienne et le 2 décembre la victoire d’Austerlitz. Après le traité de Presbourg, la paix est de retour pour un court moment.
Ces victoires, puisqu’on ne retient alors que les victoires, redonnent confiance au pays, dont l'économie est cependant loin d’être brillante ; pour relancer celle-ci, l’Empereur décide une exposition industrielle sur l’esplanade des Invalides à Paris, mais la France reste agricole et les entreprises industrielles et commerciales sont toujours en majorité structurellement fragiles, tant dans leurs techniques que dans leurs ressources financières.
Napoléon continue à étendre son pouvoir et à le centraliser. La poigne de fer de l’autorité et la censure réduisent toute opposition ; la répression, qui a suivi les complots de 1804, a frappé les esprits et découragé les opposants, la police de Fouché étant là pour y veiller. Personne ne doit manquer à l’obéissance comme le rappelle le catéchisme impérial :
Dieu qui crée les empires et les distribue selon sa volonté, en comblant notre empereur de dons, soit dans la paix, soit dans la guerre, l’a établi votre souverain, l’a rendu ministre de sa puissance et son image sur la terre.
Ce culte de la personnalité amène Napoléon à accepter, le 30 décembre 1805, pour la victoire d’Austerlitz que son nom soit désormais Napoléon le Grand. Un décret du 19 février 1806 ordonne que l’on fête, tous les ans, l’anniversaire de cette victoire qui est également la date anniversaire du couronnement.
Le jour anniversaire de la naissance de l’empereur, le 15 août, devient Saint Napoléon. Cet événement sera fêté dans de nombreuses communes du département, mais Villennes restera à l’écart de ces festivités. Il est vrai que, pendant ces dernières années, le conseil municipal de Villennes est resté très discret dans ses interventions, hormis dans ses différends avec Médan ; le retour de la famille Gilbert de Voisins qui, comme toutes les familles émigrées, tente de rentrer en possession de ses biens perdus, ne doit pas être étranger à cet état de fait. Certains des membres du conseil se sont, en effet, portés acquéreurs de biens vendus pendant la Révolution et ayant appartenus à cette famille. Le maire, Henry Lelarge, est notamment devenu propriétaire de la ferme de Marolles en 1795. Il est vrai également que le rôle du maire s'est réduit.
Le rôle du maire se réduit
En 1803, Henry Le Large a été maintenu comme les autres maires en place. Leur rôle est de plus en plus réduit devant la centralisation du pouvoir et l’autorité puissante des préfets, comme l’explique Chaptal :
Le préfet ne connaît que le ministre, le ministre ne connaît que le préfet. Le préfet ne discute point les actes qu’on lui transmet, il les applique, il en assure et surveille l’exécution de la loi et des ordres du gouvernement jusqu’aux dernières ramifications de l’ordre social.
Le rôle des maires se limite donc à appliquer les directives du préfet et à gérer la commune :
- Répartir l’impôt entre les habitants ;
- Assurer la conscription ;
- Dénoncer à la gendarmerie la présence dans leur village d’insoumis ou de déserteurs.
La répartition de l’impôt n’est pas une tâche facile, principalement dans les petites communes rurales, peu peuplées et n’ayant pas de ressources. Les dépenses prévues au budget de 1806 s’élève à 581 F. Le maire de Villennes constate :
Il n’y a pas de cabaretiers, seul le vin des récoltes est vendu, il n’y a ni boucher ni autre vendeur. Une maison est louée comme presbytère. Il n’y a ni maître d’école ni garde champêtre.
Le maire doit aussi veiller à la collecte des droits réunis (impôts indirects). Ainsi une pratique, qui était déjà en vigueur à Villennes et dans la région, est étendue à tous les vignobles, c’est le "ban des vendanges". Auparavant le maire fixait, en accord avec les propriétaires, une date de début des vendanges afin d’éviter tout conflit entre eux. Si ceci est toujours vrai, maintenant le but premier est de faciliter l’établissement des déclarations et des inventaires et d'y veiller, pour constater la quantité de vin produit par chaque propriétaire afin de pouvoir prélever les taxes.
Ces fonctions des maires ne les rendent pas très populaires auprès de leurs administrés ; accablés de charges, ils n’ont plus rien à attendre : aucune rétribution financière, aucun honneur, peu de distinction en compensation, seulement la crainte de se voir impliqués personnellement puisque leur responsabilité est reconnue engagée. Il y a également toutes les querelles de clochers, comme cela a été le cas entre Villennes et Médan, qui opposent les communes sur les regroupements de paroisses, voire de communes, ou sur des problèmes de communication. On comprend aisément que, dans de telles conditions, les candidats soient peu nombreux.
La conscription s'amplifie
A partir de 1803, le poids de la conscription se fait de plus en plus lourd avec des rappels de classes antérieures et d’interminables services jusqu’à la levée en masse de 1814.
Les conseils de révision se tiennent au chef lieu de canton, en présence d’un officier du recrutement, d’un officier de gendarmerie, d’un médecin et des maires ou adjoints des communes formant le canton. Les maires sont tenus de fournir les listes des jeunes gens de leur commune entrant dans leur vingtième année.
Les besoins en hommes devenant importants, les conseils de révision deviennent plus rigoureux, comme le montre le procès verbal du conseil du 16 mars 1805 tenu à Poissy, notre chef lieu de canton, en présence du maire de Villennes. Les conscrits, qui ont tenté de se soustraire à l’incorporation en simulant des infirmités ou s’étant mutilés, sont répertoriés sur le tableau n°5 pour "être dénoncés au conseil de recrutement" ; les insoumis sont également répertoriés, tous ces motifs étant sévèrement réprimés. La fraude est néanmoins importante et les taux d’insoumission ou de désertion restent élevés : de 15 à 20 % suivant les départements.
Les conscrits reconnus aptes au service tirent au sort, les premiers numéros désignant les plus malchanceux, ceux qui serviront dans l’armée d’active ; plus le chiffre est élevé, plus le conscrit a des chances d’échapper au recrutement, celui-ci se faisant à partir du numéro 1. Si le conseil réuni doitt fournir 100 conscrits, seuls ceux qui ont un numéro de 1 à 100 partiront avec quelques porteurs de numéros au-delà de 100 pour remplacer des réformés. Les arrangements entre conscrits sont tolérés, en particulier les remplacements dont les prix montent au fur et à mesure des années, doublant et même triplant entre 1800 et 1815 pour atteindre 4000 à 6000 francs ; les remplaçants tués ou décédés doivent faire l’objet d’un nouveau remplacement.
Le nombre de réformés est assez élevé : 33 % des 133 conscrits, en mars 1805 à Poissy, ce qui correspond à la moyenne nationale. 38 sont reconnus incapables de servir, 2 réformés provisoirement, 4 n’ayant pas la taille requise (1,63 m) ; 3 conscrits étant déjà dans l’armée, ce sont 86 qui sont soumis au tirage au sort. Parmi ceux-ci se trouvent 8 villennois, dont 2 sont réformés ne mesurant que 1,62 m ...
Les conscrits réformés doivent payer une indemnité fixée par le conseil de révision, les indigents en étant toutefois exemptés.
La loi du 25 août 1805 décharge les maires de la conscription, les conseils de révision étant placés directement sous l’autorité du préfet ; néanmoins ils seront toujours tenus de dénoncer les insoumis et les déserteurs résidant dans leur commune.
L’opinion apprécie d’autant moins la conscription que personne ne connaît la durée de la mobilisation et la destination ; normalement l’appel se fait pour quatre ans mais bien souvent ce temps dépasse les cinq ans.
La conscription sera l'une des causes de l’impopularité de l’Empire, qui feront que Napoléon sera appelé l’ogre.
Le gendre du dernier seigneur est nommé "maire de Villennes"
En mars 1807, le maire en place, Henry Lelarge, bien que
nommé en 1803 pour une durée de cinq ans, donne sa démission,
comme en témoigne le registre des délibérations de la commune :
M. d’Osmond étant nommé Maire de la commune de Villennes par M. le
Préfet de ce département en remplacement du Sieur Henry Lelarge
démissionnaire, est entré en exercice de ses fonctions et a prêté le
serment usité par la loi, le quinze mars mille huit cent sept.
La cause de sa démission est-elle liée à la conjoncture décrite précédemment ou bien fut-il démis ? Nul ne le sait, aucune lettre de démission ne figurant dans les archives départementales. En 1806 les préfets avaient dressé des listes supplémentaires de notables, des “trente plus imposés” dans le département ou des “soixante propriétaires les plus distingués par leur fortune ou leurs vertus publiques”, dans le cadre de la politique de rapprochement de Napoléon avec la vieille noblesse ; en effet, les intérêts de l’Empereur et ceux de cette noblesse commencent à se rejoindre, malgré les oppositions des irréductibles de l’Ancien Régime et de ceux de la Révolution ; l’opportunisme, le réalisme et l’ambition feront le reste.
Dans ce contexte, il n’est pas anormal de voir Marie Eustache d’Osmond devenir maire.
Le registre des maires et des adjoints, tenu par le préfet de Seine et Oise, nous précise que le maire de Villennes, M. d’Osmond est âgé de 50 ans, militaire avant 1789, colonel et maréchal de camp (général de brigade) ; ses revenus annuels s’élèvent à 10 000 F alors que la moyenne nationale des revenus de ces élus est de 3 000 F.
L’adjoint est Benoît Redeaux, âgé de 69 ans, propriétaire avant et après 1789 avec 1 000 F de revenu annuel ; ce même registre porte cette observation : “son âge l’empêche de bien remplir ses fonctions”.
M. d’Osmond sera nommé quelques années plus tard, par décret Impérial le 19 juillet 1810, conseiller d’arrondissement et on pourra lire cette observation du préfet : “Très capable et très zélé”.
Le reste du conseil municipal est composé de Nicolas Voyer, maître tuilier, Nicolas Giraux, Philippe Martin, Jean Laurent Ménard, Alexis Blot, Mathieu Duteil, Pierre Fournier, Pierre Claude Blot, François Rivièrre, tous cultivateurs.
Nomination d'un garde champêtre
Une des premières décisions de ce nouveau conseil municipal est la nomination d’un garde champêtre, le 10 mai 1807 :
Le conseil municipal jugeant absolument nécessaire d’avoir un garde champêtre pour la conservation des récoltes et des biens appartenant aux propriétaires de la dite commune; il est nommé comme garde champêtre Henry Rivièrre avec un salaire annuel de 50 centimes par arpents.
Celui-ci est le premier employé municipal de Villennes, hormis Laurent Ménard qui touche une rétribution annuelle de 60 F pour remonter et entretenir l’horloge et qui fait également fonction de tambour.
C’est à partir de 1804, que le nombre de gardes champêtres est en augmentation : si on désire une meilleure protection des récoltes et une application du ban des vendanges, remis à l’honneur à la même époque, on veut également lutter contre les braconniers qui, de plus en plus nombreux, n’hésitent pas à tirer sur les gardes ou les gendarmes quand ils se voient pris. Les gardes champêtres aideront la gendarmerie dans ses enquêtes pour les désarmer et ils lutteront contre les vols de récoltes ; ils montreront plus de zèle à protéger les cultures, leur fonction étant rémunérée, alors que les gardes messiers, qu’ils remplacent, ne l’étaient pas.
Le garde champêtre devient un personnage important dans les communes, si on en juge par les nombreuses délibérations passées à supputer son zèle et par son traitement qui sera très longtemps supérieur à celui de l’instituteur, quand il y en a un !
Le garde champêtre de Villennes, Henry Rivièrre, est confirmé dans ses fonctions, le 3 janvier 1808, par décision du conseil municipal avec un traitement annuel de 400 francs. La commission préfectorale des gardes champêtres donne son accord à cette nomination, un mois plus tard :
Commission de garde champêtre
Le conseiller d’Etat, l’un des commandants de la Légion d’Honneur, préfet du département de Seine et Oise. D’après l’avis du maire de la commune de Villennes, nomme le sieur Henry Rivière pour remplir les fonctions de garde champêtre dans la dite commune à la charge par lui de prêter entre les mains du juge de paix du canton, le serment de veiller avec soin et fidélité à la conservation de tous les fruits et récoltes qui seront confiés à sa garde, et de se conformer en outre à ce qui est prescrit par les lois sur la police rurale, notamment par celle des 28 septembre 1791 et 20 messidor An III.
On peut constater que le garde champêtre est maintenant un agent assermenté qui peut dresser procès verbal et il travaillera en collaboration avec la gendarmerie.
Nouvelles nominations au conseil municipal
La révision des nominations de maire et d’adjoint ayant lieu tous les cinq ans, le conseil municipal de Villennes est convoqué, le 28 avril 1808, pour signer sur la lettre de nomination que le préfet lui a adressée :
En vertu de l’article 20 de la loi du 28 pluviôse An VIII et du décret impérial du 15 avril 1806, M. le Conseiller d’Etat, commandant de la Légion d’Honneur, Préfet du département de Seine et Oise a continué dans les exercices de ses fonctions de Maire, M. Marie, Joseph, Eustache d’Osmond, et a nommé M. Jérôme Giraux adjoint du Maire en remplacement de M. Benoit Redaux.
Le sénatus-consulte du 28 floréal An XII prévoit que les membres du conseil municipal prêtent serment en ces termes :
“Je jure obéissance aux constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur.”
Ceci est fait le 22 mai 1808 :
A l’issue de la grande messe et dans l’église paroissiale en présence des membres composant le conseil municipal et des habitants de cette commune, Marie, Joseph, Eustache d’Osmond, Maire et Jérôme Giraux, adjoint ont prêté le serment prescrit, le dit adjoint a été installé dans l’exercice de ses fonctions.
Mise en fourrière des voitures mal garées
En 1808, Villennes connaît ses premières difficultés de circulation et l’arrêté municipal suivant est publié :
Les habitants sont avertis que les rues du village doivent être libres et débarassées de voitures. Celles qui ne seront pas mises de manière à ce que les accidents ne puissent arriver seront retirées par la police du lieu et le propriétaire pour les ravoir sera condamné à une amende. Il en sera de même pour tout animal qui sera trouvé sur les places et sans être attaché à un piquet.
Si celui-ci est le premier arrêté concernant les problèmes de circulation, ce ne sera pas le dernier !
La vaccination contre la variole
Napoléon est très favorable à la vaccination de la population contre la variole (petite vérole), à l’aide du vaccin découvert par l’anglais Edward Jenner en 1796. Il crée même, en 1804, une Société pour l’extinction de la petite vérole en France par la propagation de la vaccine ; celle-ci sera présidée par le célèbre docteur Guillotin et comprendra de grands noms de l’époque : Berthelot, Chaptal, Corvisart, Cuvier, ...
Dans la Grande Armée, Percy et Desgenettes s’efforcent de vacciner les troupes mais ils seront loin de la totalité de l’effectif, même en 1814.
Dans le pays, les préfets ont ordre d’encourager la vaccination, mais ils rencontrent des obstacles divers : la superstition, la négligence, l’hostilité du clergé et même la réticence d’une certaine partie du corps médical.
Dans le département de Seine et Oise, dés 1805, le préfet Montalivet fait savoir par voie d’affiche qu’il sera donné “des cours d’instruction sur l’inoculation de la vaccine pour les officiers de santé” ; il est précisé que les personnes, qui viendront à ces séances pour se faire vacciner, le seront gratuitement.
En 1808, le préfet suivant, M. Laumont, tente toujours de convaincre la population ; des questionnaires, envoyés aux médecins, aux maires et aux prêtres, n’obtiennent pas beaucoup de réponse. Dans notre région, seule la commune de Septeuil répond “néant” à toutes les questions.
Dans les années qui suivront, l’officier de santé d’Orgeval, François Bedelle-Deforges, vaccinera quelques habitants d’Orgeval et de Villennes.
Mais ce sera surtout la vaccination du Roi de Rome en 1811 qui aura un effet d’entraînement et un enfant sur deux sera vacciné. Montalivet, devenu ministre de l’intérieur, offrira néanmoins en 1814 des récompenses pour encourager la vaccination :
Sa Majesté ayant daigné m’allouer dans le budget de mon ministère un fond pour encourager la propagation de la vaccine, les récompenses promises aux personnes qui se distinguent le plus par leur zèle pour répandre les bienfaits de cette précieuse découverte.
Ainsi à compter de 1814 il sera décerné, pour chaque année :
- Un premier prix de la valeur de 3000 Francs
- Deux seconds prix de la valeur de 2000 Francs
- Trois autres prix de chacun de la valeur de 1000 Francs
- Et cent médailles d’encouragement aux personnes qui se seront livrées à la pratique de cette nouvelle méthode.
Les résultats seront évidents : le nombre de personnes atteintes de variole tombe au quart de celui de 1789.
Le vaccin de Jenner est également utilisé, à la même époque, pour combattre les varioles des animaux : le cow-pox pour la vache, le horse-pox pour le cheval et la clavelée pour le mouton ; les autorités ont moins de mal pour convaincre les paysans.
Un Villennois laisse les siens pour partir à la guerre,
comme de nombreux autres jeunes français
L’année 1806 voit la victoire des armées napoléoniennes contre la Prusse et leur entrée dans Berlin ; après la signature d'un armistice avec les Prussiens, ce sera également une victoire sur les Russes et la prise de Varsovie. L’année 1807 commence par une demi-victoire à Eylau contre l’armée russe, le 8 février. Ces dernières campagnes ont coûté la vie à beaucoup d’hommes et il faut à nouveau organiser, à partir du 7 avril 1807, un appel anticipé de 80 000 conscrits de la classe 1808. Le 14 juin, la victoire de Friedland amène la signature d’un armistice entre la France et la Russie à Tilsit qui sera suivi de la rencontre entre Napoléon et Alexandre Ier, le 25 juin.
La France aurait pu espérer une période de paix mais celle-ci sera de courte durée : après les campagnes à l’Est, Napoléon se tourne vers le sud et, le 29 juillet 1807, se forme à Bordeaux une armée de 20 000 hommes, pour intervenir au Portugal si ce pays ne rompt pas ses relations économiques avec l’Angleterre. Le 18 octobre, Napoléon donne l’ordre à Junot de traverser l’Espagne pour envahir le Portugal.
Les troupes de Napoléon ne se contentent pas de traverser ce pays, mais l’envahissent progressivement. Celui-ci, croyant le pouvoir royal Espagnol faible, tente de s’emparer de la couronne d’Espagne pour la confier à son frère Joseph, roi de Naples ; le 2 mai 1808, la population de Madrid s’insurge et des Français sont massacrés. En octobre, suite à ces événements, un arrêté du préfet de Seine et Oise prescrit aux maires du département :
De faire arrêter les Espagnols résidant sur leur territoire afin de servir de garantie aux Français négociants et autres, domiciliés en Espagne et qui sont détenus dans les provinces insurgées, ceux-ci seront plus tard employés dans les manufactures ou aux travaux des champs comme l’ont été les prisonniers Autrichiens.
Aussi, après le soulèvement de l’Espagne contre les troupes de Napoléon, un sénatus-consulte décrète, le 3 septembre 1808, la levée de 480 000 hommes des classes 1808 à 1810 ; c'est le début de la campagne d’Espagne.
Toutes ces campagnes, qui déclenchent l’appel anticipé des classes en âge d’être mobilisées, vident les campagnes d’hommes jeunes qui partent mais ne savent pas quant ils rentreront dans leur foyer, provoquant un mécontentement général.
A Villennes, on trouve trace de ces événements dans le registre des délibérations du conseil municipal, à la date du 26 novembre 1808, sous la forme d’un procès verbal étonnant et émouvant à la fois :
Ce jourd’hui 26 novembre 1808 s’est présenté le nommé Charles Ambroise Thuret, natif de Bouafle, âgé de 22 ans environ fils de Ambroise Thuret et de Marie Beauford vignerons au dit Bouafle. Le dit Charles Ambroise Thuret actuellement au service de sa majesté Empereur et Roi, faisant partie de la 4 ème Demi-brigade d’Infanterie légère partant pour les armées d’Espagne, a déclaré ce qui suit, savoir qu’il laisse Elisabeth Rivièrre, enceinte de huit mois ou environ de quoi il reconnaît être de son fait, et invite Messieurs les autorités constituées à baptiser l’enfant en son nom dont de plus il fait promesse à la dite Elisabeth Rivièrre, âgée de 23 ans ou environ native de la commune de Villennes, fille de Jean François Rivièrre et de Marie Anne Marguerite Blouin, vignerons et domiciliés en la commune de Villennes, de la prendre pour épouse sitôt que la loi lui permettra, ce que le déclarant promet et affirme être sincère et véritable en présence des témoins ci-après nommés Paul Marie Giraux, Antoine Michel Alouis dit Silvain, le premier marchand épicier, le second maçon patenté, tous domiciliés dans la commune.
Le registre de l’état civil de Villennes porte, en date du 2 janvier 1809, la naissance de leur fils, Jean Charles Ambroise. Le 10 septembre 1808, un sénatus-consulte exempte du service militaire les hommes mariés et les veufs pères de famille ; on peut penser que le jeune Thuret a dû regretter de ne pas avoir épousé la mère de son fils plus tôt.
Dégradations de l’église et des chemins
L’église de Villennes, qui depuis la Révolution n’a été entretenue que par des réparations succinctes, commence à présenter un état de délabrement nécessitant des travaux importants. La municipalité est également confrontée à l’entretien des chemins qui traversent la commune ; ceux-ci, restés de même longtemps sans travaux d’entretien sérieux, se sont dégradés durant l’hiver 1809-1810 du fait des mauvaises conditions climatiques.
L’ensemble de ces travaux représente une somme énorme pour le maigre budget de la commune de Villennes ; aussi le 5 août 1810, le conseil municipal se réunit et déclare :
Vu l’indispensable nécessité de rétablir l’église afin de prévenir les accidents. Vu celle non moins urgente de réparer une rue en terrasse, dégradée par les eaux et celle de refaire une fontaine servant de lavoir. Vu le peu de ressources qu’offrent la fabrique et les fonds communaux pour pareilles réparations. Le conseil municipal de la commune de Villennes assemblé extraordinairement d’après l’autorisation de Mr le préfet. Arrête quérative prière serait faite à Mr le préfet pour obtenir du Conseil d’Etat la permission de prélever sur les contributions de la dite commune une somme de 2400 Francs payable en quatre années, savoir 600 Francs par an, laquelle somme sera employée aux ouvrages les plus pressés sous la surveillance et responsabilité du conseil qui prendra connaissance des règles et des travaux.
La demande est transmise par la préfecture et le 22 janvier 1811 un décret impérial autorise une imposition extraordinaire sur les contributions pour la somme de 2 400 francs :
Extrait des minutes de la secrétairerie d’Etat au palais impérial des Tuileries, le 22 janvier 1811, Napoléon Empereur des Français.
Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur notre Conseil d’Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
La commune de Villennes département de Seine et Oise est autorisée à s’imposer extraordinairement en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 2400 Francs en quatre ans pour payer le prix des réparations à faire à l’église, au lavoir et à un mur de terrasse. Les dites réparations seront adjugées au rabais.Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.
Signé Napoléon pour l’Empereur, le Ministre Secrétaire d’Etat signé H.B. duc de Bassano pour ampliation le Ministre de l’Intérieur, comte de l’empire, Montalivet.
Toutefois, il faudra attendre pour voir la réalisation de ces travaux, en particulier ceux concernant l’église.
Pour le chemin dont il était question, c’est seulement l’année suivante, le 8 décembre 1812, que le conseil municipal, convoqué extraordinairement par le préfet, décide
Il apparaît au conseil municipal que le chemin qui exige le plus de réparations est celui connu sous la dénomination du Clos du pape qui sert de débouché aux communes de Médan, Vernouillet et Verneuil. Ce chemin contenant 248 toises, évaluées par l’ingénieur géographe (Mr Duchesne) à 988 Frs, exige de plus qu’il y soit fait un mur de terrasse de 82 toises estimées y compris fondations évalué à la somme de 816 Frs. Le conseil arrête qu’il serait fait une criée au rabais et que des affiches seraient envoyées pendant trois dimanche dans les communes voisines.
Ce chemin est l’actuelle rue Gallieni sur une longueur d'environ 480 mètres à partir de l’intersection avec l’avenue Georges Clémenceau.
Nouvelles nominations au conseil municipal
Pendant l’année 1811, un seul changement intervient dans le conseil municipal avec le décès de Giraux Nicolas, remplacé le 23 septembre 1811 par Henry Le Large, qui prête serment le 11 décembre 1811.
L’année suivante, le conseil municipal verra plusieurs nominations. Si M. d’Osmond est maintenu à la fonction de maire le 1er septembre 1812, Jean Le Bat, négociant, est nommé adjoint (n'habitant pas régulièrement à Villennes, il sera remplacé par Jérôme Giraux, 6 mois plus tard) ; deux conseillers décédés seront remplacés, le 9 juin : Pierre Blot par Paul Giraux et Jean-Baptiste Souhard par Martin Roi (fils).
Les épidémies
Si la variole, comme nous l’avons vu précédemment, est en recul du fait de la vaccination, les autres maladies comme la rougeole (on ne parle pas encore comme ce sera le cas l’année suivante de typhus ou de choléra), la scarlatine et la diphtérie restent virulentes et font des ravages.
Les médecins sont peu nombreux et de formations très diverses. Il y a les médecins issus des écoles de santé et les officiers de santé, en plus grand nombre, de formation très sommaire, agréés par des jurys médicaux départementaux qui les recrutent avec des compétences territoriales limitées.
Quant aux pharmacies, elles sont peu nombreuses, quelques unes par département. Sur les marchés, des charlatans vendent de prétendus remèdes et potions sans aucune efficacité ; des épiciers et des droguistes vendent également des préparations de leur création qui échappent à tout contrôle.
Au printemps 1812 éclate dans notre canton une épidémie de rougeole, qui commençant à Poissy touche tous les villages des alentours : en particulier, Villennes, Orgeval et Médan. Le médecin des épidémies, le docteur Texier, envoyé à Poissy sur ordre du préfet, note dans son rapport, adressé à celui-ci, que lors de son arrivée déjà trente et un enfants étaient morts et que, pour établir son enquête sur le développement de cette épidémie, il a visité soixante malades. Après avoir donné une description des symptômes de la rougeole, il expose le traitement qu’il préconise au début de la maladie : administration de vomitifs, par l’absorption de boissons “mucilagineuses”, légèrement sudorifiques et régime diététique “convenable” ; il précise que cela suffit quand la maladie a été simple. Les complications avec “la fièvre dynamique” sont, quant à elles, combattues avec des moyens à “relever les forces” et à “produire une grande excitation” comme le quinquina et les viscications et en fin de maladie, après la desquamation, les purgatifs suivant les besoins.
Ceux qui réchappaient de ce traitement devaient avoir une bonne constitution !
Les réparations de l'église commencent enfin
Après trois années d’attente d'une prise de décision, dont on ignore la raison du retard, les travaux de réparation de l’église vont enfin se réaliser. Ce délai a dû augmenter l’état de décrépitude du bâtiment ...
Le conseil municipal se réunit donc pour mettre en adjudication ces travaux :
Ce jourd’hui 28 mars 1813 à trois heures après-midi, nous maire de la commune de Villennes assisté de Mr l’adjoint et des sieurs Duteil, Blot et Rivièrre, membres du conseil municipal avons procédé à l’adjudication au rabais des ouvrages à faire à l’église de Villennes ainsi qu’il est constaté suivant le devis annexé au présent.
Bougie ayant été allumée et la dernière s’étant éteinte vierge pour la sous enchère de 698 Francs faite au Sieur Blouin, maçon patenté demeurant à Villennes, nous lui avons adjugé les réparations de l’église.
La maison commune : mairie, école et presbytère
 |
Durant la Révolution, la maison servant de presbytère avait été vendue comme bien national ; aussi après la signature du Concordat et le retour des prêtres, pour loger le desservant (le curé), la municipalité de Villennes loue une maison, qui constitue une charge supplémentaire pour son budget. |
Le 20 septembre 1813, le maire, M. d’Osmond propose, de faire des travaux dans l’ancien hospice ou maison des sœurs, qui est devenue la mairie et certainement l’école ; en vue de faire des économies, il présente donc un projet de transformations à effectuer dans ce bâtiment pour y loger le prêtre et l’instituteur. Dans sa lettre, il n’oublie pas de rappeler la spoliation, dont les biens de sa femme, Anne-Marie Gilbert de Voisins, ont été l’objet :
Monsieur, La maison dite des sœurs conservée en 1794 comme maison commune au détriment du presbytère vendu à cette époque, et affectée dorénavant par un arrêté de monsieur le préfet à loger aussi le desservant ce qui économisera à la commune sur son budget une somme annuelle de 120 à 130 Frs se compose au rez de chaussée de trois grandes pièces dont deux avec cheminée, d’un escalier ne donnant sur aucune de ces pièces.
Au premier d’une salle à manger avec cheminée, d’un salon, deux chambres à coucher (à feu) quatre grands cabinets, grenier, avec un jardin de 60 perches à peu près - deux entrées séparées. Cette maison étant trop considérable pour un curé et la commune ayant besoin d’un lieu de rassemblement, j’ai pensé que le même local qu’elle réservait pour ses séances pourrait encore servir à y établir un maître d’école dont elle a un besoin urgent. En conséquence, j’ai l’honneur de vous proposer, Monsieur, de nous autoriser à faire quelques petits changements qui rendraient indépendant, le pasteur et le magistère.
L’état ci-joint vous indique d’après le nouvel arrangement que Mr le curé se trouverait avoir la principale entrée - une cave - une cuisine en bas - au premier, salle à manger, salon, deux chambres à coucher - quatre grands cabinets et un grand grenier plus jardin. Mme d’Osmond affichera une prétention sur une portion de ce jardin; c’est à vous Monsieur à juger si elle y est fondée tant qu’elle a pu espérer du gouvernement qu’il rendrait ses rentes affectées à cet acte de bienfaisance fondé par son père, elle a concédé devoir faire aucune démarche afin de recouvrer peut-être la 10 ème partie d’un arpent, mais aujourd’hui qu’il parait constant que cette fondation ne peut pas revivre et que Mme d’Osmond a été dépouillée d’une manière peu commune, il lui importe de respecter la plus petite chose. La copie du testament que j’ai remise à Mr de Choiseul et la notoriété publique seront les titres sur lesquels vous vous prononcerez Monsieur. J’ai l’honneur d’être avec une haute considération, Monsieur, votre très humble serviteur. Osmond.
Le préfet a porté une annotation sur la lettre de M. d’Osmond :
Mr Ménager, cette réponse parait juste, demander au maire le moyen de faire payer ces 130 frs, le restant disponible du budget n’est peut-être pas suffisant il faudra je crois une imposition extraordinaire.
Nous ne savons pas comment les travaux furent financés, mais il est certain qu’ils ont été exécutés, car il est exact que l’instituteur et le prêtre résidèrent ensemble dans cette maison.
Les revers de l’Empire
Pendant deux ans, en 1810 et 1811, la France peut jouir d’une paix quasi générale hormis le conflit avec l’Espagne, ce qui permet à Napoléon de se consacrer à des œuvres de prospérité et de progrès. L’Empire est à son apogée. Le remariage de l’Empereur et la naissance du Roi de Rome, en mars 1811, sont sensés redonner confiance aux Français pour l’avenir ; malheureusement la prospérité est de courte durée, des greniers vides réveillant,au printemps 1811, la crainte ancestrale de la famine.
En réalité, plus l’Empire s’étend plus il devient complexe, difficile à gérer et par ce fait fragile. Les armées ne peuvent réduire la révolte espagnole, montrant ainsi leur faiblesse et démontrant que tout ennemi résolu peut se révolter.
En mai 1812, c’est la rupture de l’alliance russe de Tilsit et, le 9 mai, Napoléon quitte Saint Cloud pour la campagne de Russie. On connaît la suite : que ce soit par le climat, la malchance ou par les Russes eux-mêmes, la grande Armée est battue. Celle-ci doit battre en retraite pendant presque trois mois et l’on ne retrouvera jamais la cavalerie et l’artillerie englouties dans les neiges et la boue de la steppe russe. L’Empire va perdre aussi l’obéissance admirative ou servile des troupes alliées et l’édifice politique, diplomatique et militaire mis en place depuis dix ans par Napoléon va s’effondrer.
La nouvelle de la déroute en Russie parvient à Paris le 16 décembre 1812.
Durant l’année 1813, les troupes françaises évacuent l’Espagne. A l’Est, en Allemagne, Napoléon connaît encore quelques victoires, mais ce seront vite des batailles perdues, principalement la bataille de Leipzig ou bataille des Nations, qui se déroule du 16 au 19 octobre. Napoléon y perd 50 000 hommes dont 20 000 tués sur 170 000. Au terme de cette bataille, l’Allemagne est définitivement perdue et, en quelques semaines, après la trahison de nos alliés, les Saxons et les Wurtembergeois, on revient aux frontières de 1792.
A partir du 2 novembre, c’est une armée éprouvée, commençant à être décimée par le typhus, qui repasse le Rhin. Napoléon qui est revenu à Paris lève à la hâte une armée, en utilisant les procédés habituels de mobilisation : rappel des conscrits des classes antérieures depuis 1808, levée de jeunes âgés tout juste de 18 ans (qui seront appelés les “Marie-Louise”), engagement de volontaires et de gardes nationaux. On parle de levée en masse mais le cœur n’y est plus ; le peuple ne veut entendre parler que de paix. Les émeutes se multiplient. On se marie de plus belle pour échapper au recrutement et les cas de désertion sont de plus en plus nombreux.
Le 25 janvier 1814, c’est seulement avec 60 000 hommes, avec une cavalerie et une artillerie maigres, que Napoléon commence la campagne de France. Les Alliés menaçant de toute part, les Autrichiens se répandent depuis Belfort en Bourgogne en Franche-Comté et en Savoie. Les Suédois attaquent sur l’Escaut alors que les Russes et les Prussiens interviennent en Lorraine. En Alsace, Napoléon remporte encore quelques petits succès, qui ne peuvent pas retourner la situation, et il se retire sur Paris.
Pendant toute la période de repli des armées françaises, un grand nombre de malades et de blessés traversent la région et une épidémie de typhus se développe principalement dans le sud du département. A Versailles, 2 400 malades sont hospitalisés un peu partout ; le médecin de cet arrondissement précise dans une note : “Une maladie s’est manifestée dans quelques départements, c’est le typhus ou Fièvre des camps, Fièvre des hôpitaux, Fièvre des prisons”. Il explique également la naissance de la maladie, la contagion et la propagation ; "le remède", dit-il, “consiste en fumigations de nitrate”. Villennes n'est pas atteint par cette épidémie contrairement, vraisemblablement, à Poissy où résident des malades et des blessés, dont on évacue un grand nombre par la Seine, notamment sur Rouen.
Dès les premiers jours de février, le préfet nommé le 13 janvier 1814, le baron Delaître (précédemment préfet de l’Eure de 1800 à 1813), doit faire face à cet afflux de troupes ; il organise des réquisitions pour faire entrer dans les magasins de Versailles 303 000 bottes de foin, autant de paille et 26 000 hectolitres d’avoine. Les réquisitions se succèdent sans arrêt, sept concernant les chevaux, du 5 février 1813 au 21 février 1814. En effet, le transport des blessés et des malades, les convois nécessitent un grand nombre de chevaux. Un millier de vaches doivent être fournies en février, puis de nouveau 2 000 chevaux de trait.
Le 30 mars, sous la pression des armées alliées, tous les dépôts de cavalerie sont évacués sur les départements de l’Ouest ; le préfet quitte Versailles et, le même jour, Paris capitule.
1814 : la première Restauration
Le préfet bonapartiste se rallie à Louis XVIII
|
Le 4 avril, Napoléon abdique sous réserve des droits du Roi de Rome et de l’Impératrice régente. Deux jours plus tard, il abdique sans condition. Aussitôt, le Sénat adopte une nouvelle Constitution et proclame Roi des Français, sous le nom de Louis XVIII, le comte de Provence, frère de Louis XVI.
|
 |
Le préfet de Seine et Oise, Jean Marie Delaitre, baron d’Empire, qui dût être fidèle à l’Empereur pour durer si longtemps, doit quitter Versailles sur ordre au début du mois d’avril ; il est de retour le 6 de ce mois. Le lendemain, dès la réception de l’avis d’abdication de l’Empereur, il s’empresse de supprimer les emblèmes bonapartistes et, le 8 avril, il adresse aux maires du département un avis leur annonçant l’abdication de Napoléon et la formation d’un gouvernement provisoire. Il doit également faire face à l’occupation des armées alliées ; après avoir obtenu, vers le 10 avril, quelques retraits de troupes, elles sont aussitôt remplacées par d’autres ...
Le préfet Delaitre, comme tant d’autres, se rallie aux Bourbons, les flattant avec autant d’ardeur qu’il en met à outrager son ancien maître. Ainsi le 15 avril, le jour où le comte d’Artois précédant son frère, Louis XVIII souffrant, arrive à Paris, le préfet expédie aux maires une note relatant l’événement. Elle se termine par les mots suivants :
Veuillez, Messieurs, donner connaissance de ces détails si touchants à tous vos Administrés, qui ne les entendront pas, j’en suis convaincu, sans émotion et sans attendrissement.
L’occupation du département et les réquisitions
La préoccupation première des maires se situe certainement ailleurs, car le département de Seine et Oise est alors occupé par 27 500 hommes, accompagnés de 24 765 chevaux. Presque la moitié est constituée de Russes, le reste comprenant 9 700 Autrichiens, 1 500 Prussiens et 3 000 lanciers Polonais. Mêlés à ceux-ci, se trouvent 2 300 hommes et 630 chevaux des armées françaises qui n’ont pas pu évacuer à temps le département.
La présence de toutes ces troupes entraîne des réquisitions importantes. Devant cet état de fait, les maires des cantons de Saint Germain en Laye et de Poissy se réunissent à la mairie de Saint Germain, le 9 avril, pour délibérer sur le mode à suivre “pour subvenir aux réquisitions continuelles qu’on leur impose de tous côtés" ; ils choisissent pour les représenter M. d’Osmond, maire de Villennes, M. de Tocqueville, maire de Verneuil, M. de Moyria, maire de Conflans et M. Geofroy, maire d’Andrésy.
Ils dénoncent les réquisitions qu’ils jugent arbitraires “quant à la quotité des choses requises et quant au mode suivant lequel elles sont demandées. Que tout est livré à l’arbitraire du militaire qui se transporte dans les communes et exige de vive force sans aucun ordre écrit et sans aucune autorisation émanant de l’autorité civile”. Ils font remarquer aussi que les demandes qu’ils doivent satisfaire sur-le-champ sont parfois “sans rapport avec les ressources respectives des communes ou les richesses des particuliers”. Ils protestent contre les brutalités dont leurs administrés sont l’objet “Que l’apparition des détachements armés, la violence qu’ils témoignent lorsqu’on leur représente l’impossibilité de satisfaire à leurs demandes, ceci excite un mécontentement général et peut amener à chaque instant, des rixes extrêmement fâcheuses entre les militaires et les habitants”.
Pour remédier à ces abus et pour calmer l’inquiétude générale ils proposent la mesure suivante :
Que préalablement à tout on obtienne des autorités militaires Russes, Prussiennes et Autrichiennes, de donner les ordres les plus précis pour qu’on ne fasse partir aucun détachement, sans qu’il ne soit accompagné d’un officier français, porteur d’ordres légalement délivrés, fixant la quantité des objets demandés.
Ils demandent ensuite que cette mesure ne soit que temporaire et que celle-ci soit remplacée le plus tôt possible “par l’établissement de magasins fixes, auxquels les communes livreront les contingents qui leur seront attribués par l’autorité supérieure, après une vérification exacte de leurs besoins et de leurs ressources”.
Le préfet s’engage à fournir aux troupes alliées une ration au prix de 0,70 F par homme et par jour, dans le même temps on constate que la ration fournie aux soldats français ne doit pas dépasser 0,50 F et que ceux-ci doivent se contenter de denrée de qualité inférieure.
Dans l'arrondissement de Versailles dont Villennes dépend, les relations entre la population et les soldats des troupes alliées qui nous occupent sont nettement mauvaises avec les Prussiens et relativement bonnes avec les Russes, sauf avec les Cosaques, trop sauvages pour nos paysans. M. de Jouvencel, maire de Versailles, relate dans son journal les violences commises par les troupes prussiennes qui ont occupé en premier sa ville. La situation s’améliore avec l’arrivée des Russes et du Grand Duc Constantin.
Dans la campagne, où les soldats, loin des états-majors, sont plus livrés à eux-mêmes, il y a de nombreuses scènes de pillage. Les quelques cent lettres de maires adressées au préfet sont formelles à cet égard : “Les soldats déclaraient qu’on leur avait promis le pillage de Paris” ; trompés dans leur attente, ils se rattrapent sur les campagnes.
Le 27 avril 1814, sur convocation du préfet tous les maires du canton se réunissent à l’hôtel de ville de Poissy, chef lieu. Villennes est représenté par M. Giraux, adjoint au maire, M. d’Osmond ayant quitté la commune depuis quelques jours. Le maire de Poissy, M. Faron, qui préside la séance, demande aux maires ou adjoints assemblés s’ils ont réuni leur conseil pour le consulter ; le préfet leur avait, en effet, demandé de débattre sur les sujets suivants :
- sur les moyens à employer pour former des magasins d’approvisionnement sur les points les plus centraux du canton de Poissy à l’effet de pourvoir aux besoins des troupes qui sont ou pourraient être placés dans les différentes communes qui le compose.
- sur le mode de prestation en nature ou en valeur représentative des fournitures, vivres, et fourrages, qui doivent être livrés aux troupes cantonnées.
- pour indiquer les bases qui seront les plus équitables pour établir le système des réquisitions ou la répartition du prix des fournitures faites par voie d’achat.
Les maires réunis déclarent que "les avis de leurs conseils municipaux ont été les mêmes et ont tendu à manifester l’opinion unanime" :
- qu’il y a lieu d’établir un magasin central à Poissy,
- que les prestations doivent être faites en valeur représentative et non par voie de réquisition,
- que les bases de répartition qui leur paraissent les plus équitables doivent être assises sur les contributions directes par forme de centimes additionnels.
Cette assemblée prend donc la décision suivante :
A l’égard du premier objet de délibération considérant que la ville de Poissy se trouve au centre du canton, que l’arrivage y est très faible puisque la grande route la traverse et qu’elle est environnée de routes qui y aboutissent, que d’ailleurs les bâtiments destinés au dépôt de mendicité offrent un local suffisant pour l’établissement d’un magasin. Est d’avis qu’il y a lieu d’établir un magasin central à Poissy dans les bâtiments destinés au dépôt de mendicité.
Il est décidé également que, si les autorités le demandent, un autre magasin pourrait être établi à Crespière bien que “le pays n’offre que peu de ressources et ne contient point de local propre à cet établissement”.
Pour le second objet de délibération, il est considéré que le mode de réquisition ne peut être adopté pour un gouvernement paisible, que la prestation en nature présente des inconvénients en mettant en avance la classe des habitants du canton, que par leurs récoltes, ou autrement, sont les seuls en l’état de fournir d’abord à ces réquisitions.
Quant au troisième objet, considérant que les contributions foncières et mobilières apparaissent comme les bases les plus équitables pour la répartition des sommes à verser, l’assemblée est d’avis que la répartition des sommes à payer doit être faite entre les contribuables eus égard au montant de leurs contributions directes en conséquence, qu’il soit, de ces différentes sommes, fait et dressé un rôle supplémentaire par forme de centimes additionnels, lequel rôle sera rendu exécutoire par les autorités compétentes et pour la perception en être confié au receveur des contributions de chaque commune.
L’occupation des alliés dure jusqu’à la fin juin 1814. Les dépenses sont payées par un impôt supplémentaire d’un cinquième sur les contributions directes, qui s’élève à 1 223 210 F, mais cette somme rentre bien lentement : au Conseil Général du 24 octobre, le préfet annonce que les 3/8 seulement en ont été versés.
L’occupation de Villennes et des environs par les troupes alliées
L’occupation des villages environnants et de Villennes commence en avril 1814, pour se terminer en juin. Les premiers à subir cette occupation sont les Alluets et Orgeval ; 92 cavaliers des cuirassiers de la Garde Impériale Russe occupent ce dernier, ensuite l’ensemble de cette Garde Impériale se répartit dans tous les villages des environs de Saint Germain en Laye, où réside son état-major, avec à sa tête le général Ermoloff.
Le régiment de fusiliers de la Garde “Ismalosky” occupe Orgeval : 2 176 hommes sont répartis dans 300 maisons. Un autre régiment de fusiliers “Littowsky” occupe Ecquevilly, Morainvilliers et Villennes avec 2 282 hommes ; dans notre commune, environ 700 hommes sont logés dans 90 maisons, chaque habitant ayant à loger de 7 à 10 soldats suivant l’importance de sa maison. Quant à Médan et Vernouillet, ils seront occupés par les grenadiers de la Garde. Ce corps de troupe est pourvu de 2 000 chevaux qu’il faut également nourrir. Il en coûtera à Villennes 1 965 F pour les vivres et le fourrage, en plus des tracas que cette occupation occasionne.
Lors du départ de ces troupes d’occupation à la fin de juin 1814, il y a beaucoup de désertion surtout parmi les troupes russes. La raison en est-elle la perspective de la longue route à faire ou comme le dit le préfet “la douceur de notre climat” ? On sait, par contre, que ces hommes travaillent presque tous dans les fermes, où la main d’œuvre manque, et que de plus ils se contentent d’un faible salaire. Cependant, le préfet affirme : "Je rejette l’idée d’une telle spéculation, et j’aime à me persuader, au contraire, que si quelques habitants accordent un asile à ces étrangers, c’est par un sentiment d’humanité”.
La gendarmerie engage des recherches dans le département, en particulier dans notre canton à Orgeval et à Morainvilliers. Ces hommes doivent être ramenés dans des dépôts formés à Paris et à Reims par les troupes alliées, qui se retirent, mais beaucoup passent au travers des mailles du filet et font souche en France.
Le retour des conscrits au pays
A partir de la fin du mois de juin 1814, l’adjoint Nicolas Jérôme Giraux, en l’absence du maire, enregistre les noms des soldats de la Grande Armée qui sont libérés ; les deux premiers arrivent le 24 juin après le départ des troupes russes : Pierre Moisson, soldat du 15ème Régiment d’Infanterie de ligne, réformé, Louis Denis (Liégard) sergent au 74ème Rgt d’Infanterie de ligne, conscrit de l’An XIII (1804-1805) en congé de réforme.
D’autres mettent plus de temps à revenir : le 22 août, Michel Frerrot, soldat au 1er Rgt de Voltigeurs de la ”ci-devant” Jeune Garde, conscrit de l’An XIV (1805-1806), blessé et qui est muni d’un laissez-passer russe ; le 27 août, c’est Jacques Rivièrre qui se présente, soldat au 14 Bataillon du train d’Artillerie, réformé, ainsi que Jean-Pierre Bonnat, réformé depuis le 30 avril, soldat du 85ème Rgt d’Infanterie de ligne, conscrit de l’An XIII (1804 - 1805). Suivent Pierre Jean Gaury, conscrit également de l’An XIII, réformé pour ”perte de dents”, Michel Voyer conscrit de 1812, libéré, soutien de famille, Pierre voyer, libéré depuis le 2 avril, cavalier au 2ème Rgt d’Eclaireurs de la jeune Garde, libéré ”comme fils de femme veuve”. Le dernier, Pierre Chapitrat, Grenadier au 2ème Rgt de la Vieille Garde, en congé absolu depuis le 28 juin, est natif de Brusseau dans les Deux-Sèvres mais il se fixe à Villennes où il travaillera comme garde moulin.
On constate que tous ces hommes sont réformés ou soutiens de famille et qu’ils ont presque tous passé 9 à 10 ans sous les drapeaux. Heureux ceux qui rentrent, car les malades et les blessés sont abandonnés à leur sort ! Quand ils sont réformés ou libérés, ils doivent regagner leur foyer par leurs propres moyens. Les prisonniers français libérés en Allemagne ou dans d’autres pays d’Europe doivent rentrer également par leurs propres moyens, mais il en est de même pour les prisonniers qui ont été amenés en France, dont certains travaillent depuis dix ans pour des travaux d’utilité publique.
On estime à 200 000 le nombre de Français disparus ou prisonniers en Russie. Un grand nombre restera dans le pays. En 1837, un recensement dénombrera 3 229 anciens prisonniers français dans la ville de Moscou.
Nombreuses sont les familles françaises qui recherchent un membre de leur famille qui a disparu ; ceci durera au moins pendant 15 ans, comme en témoigne les nombreux avis de recherche figurant aux archives de notre département.
Le nouveau serment de fidélité (au Roi)
|
Napoléon déchu, acceptant la souveraineté de l’île d’Elbe, fait le 20 avril 1814 des adieux touchants à sa vieille Garde. Le 30 mai, Louis XVIII entre dans Paris et s’installe aux Tuileries. |
 |
Après la publication de la charte constitutionnelle par le nouveau roi, la signature du traité de Paris, redonnant à la France ses frontières de 1792, et l’évacuation des troupes étrangères, l’administration du pays peut reprendre. Dans les départements, la plupart des préfets sont maintenus dans leur fonction.
Le premier Conseil Général du département se réunit le 15 octobre par ordonnance du Roi, sous la présidence du préfet Delaitre qui déclare :
L’an 1814 le 20ème du règne de Sa Majesté Louis XVIII, surnommé par la voix de son peuple Louis le Désiré, le 15 octobre, pour l’ouverture des Conseils Généraux des départements.
Le président de séance présente au conseil la formule du serment que chacun des membres doit prononcer :
Je jure et promets à Dieu de garder obéissance et fidélité au Roi, de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue qui serait contraire à son autorité, et si, dans le ressort de mes fonctions ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose à son préjudice, je le ferai connaître au Roi.
Le conseil municipal de Villennes s'est déjà réuni, le 2 octobre 1814, pour prêter le serment de fidélité au Roi :
Moi Nicolas Giraux adjoint de Monsieur le Maire, en son absence, ayant reçu le dit serment de chacun des membres et individuellement qui a été prêté par eux unanimement. Nous avons dressé procès verbal le 2 octobre 1814.
Celui-ci est signé par tous les membres du conseil : Pierre Fournier, François Rivièrre, Mathieu Duteil, Giraux Paul, Philippe Martin, Jean Laurent Menard, Henry Lelarge, Nicolas Voyer, Martin Roi (fils), Nicolas Jérôme Giraux, adjoint.
Les maires et adjoints du canton ont préalablement prêté le serment devant le sous-préfet, à Poissy, suivant les instructions préfectorales du 6 août 1814.
Le pont de l’île de Villennes : encombrements et écroulement
Le 17 septembre 1814, l’adjoint au maire, suite à des plaintes, est obligé de signifier, aux sieurs Luce et Decoudre, les meuniers propriétaires du moulin qui se trouve situé sur le pont de l’île, que ceux-ci ne laissent à l’avenir aucune voiture ni chevaux attachés sur le dit pont, de gêner en aucune manière le passage et de boucher les trous qui se font sur le dit pont et les rend responsables des malheurs qui pourraient en résulter soit en laissant des voitures ou chevaux attachés sur le dit pont, ou défaut d’entretien.
Le garde-champêtre est chargé de faire respecter cet arrêté. Ce pont semble en assez mauvais état et le charroi incessant en détériore son tablier et ébranle ses piles. Aussi, lorsque l’irréparable se produit dans la nuit du 21 au 22 décembre, une arche du pont s’écroule entraînant la destruction du moulin en totalité, il ne reste plus à l’adjoint du maire qu'à dresser un procès verbal pour “y avoir recoure au besoin”.
Retour du curé, après la restauration de la religion de l'Etat ?
Si le concordat en 1801 a rétabli la liberté du culte et une grande partie des églises ont été ouvertes, il n’y a pas de religion d’état ; de ce fait, les prêtres ne sont point rémunérés, vivant uniquement du denier du culte. Aussi dans beaucoup de petites communes, comme à Villennes en l’année 1815, leurs revenus étant trop faibles, ils ne restent que peu de temps.
Lorsque Louis XVIII, après son retour sur le trône, accorde la Charte, l’article 5 de celle-ci précise que “Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection”. L’article suivant est plus précis : “Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’Etat”.
Les prêtres vont donc être à nouveau rémunérés.
Le 14 janvier 1815, le conseil municipal de Villennes se réunit extraordinairement suite à la circulaire du préfet du 24 septembre concernant le traitement du desservant. Le conseil reconnaît l’utilité de faire un traitement annuel au desservant de cette commune non volontaire (cette manière étant mauvaise, sujet au caprice de quelques habitants qui réduiront leurs promesses à rien), mais sur un rôle exécutoire.
En conséquence le conseil voyant la bonté et l’ordre de sa majesté pour le fondement de la religion a voté une somme de trois cents francs qui sera prélevée annuellement pour le traitement du desservant suivant les ordonnances.
Le conseil a l’honneur de représenter à Mr le préfet que la commune étant sans prêtre depuis environ trois mois les budgets de la fabrique n’ont point été faits, il est impossible de les envoyer, ainsi que la circulaire le prescrit. Le conseil assure à Mr le préfet que les revenus de la fabrique étant bien petits même en mettant toute l’économie possible, on a peine à couvrir les dépenses du culte.
Le dernier prêtre, résidant à Villennes, était Baltazar Carpentier qui avait été nommé dans la paroisse le 1er avril 1810, et l'avait quittée le 10 octobre 1814 ; le registre du préfet concernant les desservants du canton précise : “s’est retiré sans rien dire”. Son remplaçant Louis René Herblin, ancien desservant d’Achères, est nommé le 15 août 1815 mais il est noté dans le registre : “ne semble pas s’être présenté”.
1815 : les Cent Jours
Le retour de Napoléon
Si les Français lassés des guerres continuelles ont accueilli l’arrivée de Louis XVIII avec soulagement, le désenchantement arrive vite. La charte “accordée” par le roi, l’abandon du drapeau tricolore, les prétentions autoritaires de certains nobles et de certains prêtres font croire au retour de l’Ancien Régime et le mécontentement s’installe pendant l’hiver 1814-1815.
Les nouvelles de France qui arrivent à l’île d’Elbe révèlent à Napoléon la montée d’une opposition certes floue, mais évidente. Suite aux nouvelles de Vienne, certainement enflées par les agents de Talleyrand, lui faisant craindre un assassinat ou un enlèvement, Napoléon débarque, le 1er mars, à Golfe Juan.
Vingt jours plus tard, il entre dans Paris que Louis XVIII a quitté la veille pour s’exiler, cette fois à Gand. Napoléon aura donc traversé la France sans qu’aucun coup de fusil ne soit tiré. Le 7 mars, les troupes envoyées à sa rencontre se sont ralliées à lui avec enthousiasme. Ce retour a été rendu possible grâce au soutien d’une grande partie de la population, qui désapprouvait les choix fondamentaux de Louis XVIII ; la présence d’une réaction jacobine, qui revendique un nouveau pouvoir, crée cependant une certaine ambiguïté. S’il y a un rejet de l’Ancien Régime, c’est la puissance des idées libérales qui se fait jour plus que l’adhésion au bonapartisme.
Dès son arrivée à Paris, Napoléon se rend compte de la complexité de la situation et de l’évolution des esprits en un an, qui l'obligent à faire des concessions : il fait rédiger par Benjamin Constant une nouvelle constitution appelée “Actes additionnels aux constitutions de l’Empire”. Des élections sont organisées : il en résulte une Chambre des représentants “libérale et parlementaire” (très peu d'élus sont bonapartistes), plutôt républicaine, mais avant tout hostile aux Bourbons.
Le nouveau serment de fidélité (à l'Empereur)
Précédemment, les conseils municipaux ont déjà prêté serment à l’Empereur, comme à Villennes le 23 avril. Le conseil s’étant réuni sur convocation du préfet, l’adjoint au maire Nicolas Giraux, en l’absence du maire M. d’Osmond prête donc “serment de fidélité à sa majesté l’Empereur” devant le conseil municipal qui prête serment à son tour, tous les conseillers étant présents.
Les maires sont à nouveau élus
Les actes additionnels ont rétabli la loi de 1789 pour les élections municipales et le décret du 30 avril 1815 prévoit que dans toutes les communes, dont les municipalités sont à la nomination des préfets, il sera procédé, par les habitants ayant droit de voter dans les assemblées primaires, à l’élection des maires et des adjoints.
Le préfet envoie ses instructions, le 5 mai 1815, pour l’organisation de telles élections dans les communes du département.
Celles-ci ont lieu le 14 mai à partir de huit heures : il est procédé en premier lieu à l’élection des membres du bureau de vote, sous la présidence du doyen d’âge des habitants présents. A Villennes, Benoit Redeaux est assisté du plus jeune, Nicolas Michel Conté, comme secrétaire, et de Mathieu Duteil, Pierre François Darenne et Alexis Blot, les trois plus âgés après le président. Participent à cette élection 51 votants ; chacun donnant son nom au moment du vote, il est ainsi dressé une liste électorale. A l'issue des deux premiers scrutins, Benoit Redeaux et François Simon sont proclamés respectivement président du bureau de vote et secrétaire ; Pierre Fournier, François Roy Martin et Henry Lelarge sont élus scrutateurs lors d’un troisième vote. Ce bureau prête serment d’obéissance aux constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur.
Le résultat de l'élection est le suivant :
| Maire | Nicolas Jérôme Giraux |
| Adjoint | Pierre Fournier |
Le 18 juin 1815, alors que Napoléon livre bataille à Waterloo, ces deux nouveaux élus sont installés officiellement dans leur fonction et ils prêtent serment.
La chute : nouvelles occupation et restauration
La bataille de Waterloo est perdue et, pour la première fois, la panique s’empare des troupes françaises dont la retraite se transforme vite en débâcle. Une partie tente en vain de se regrouper à Laon, mais sans Napoléon qui se rend le plus vite possible à Paris pour tenter de sauver la situation.
La coalition eût été moins intransigeante si elle avait senti en France un sursaut national. Hélas, le pays est fatigué et le choc espéré par le retour de Napoléon n’a pas eu lieu ; il apparaît plus comme une entrave à la paix et, dans sa versatilité, l’opinion le repousse aussi vigoureusement qu’elle l’a applaudi trois mois auparavant.
Le 22 juin 1815, Napoléon abdique pour la seconde fois.
Notre région va voir, une fois de plus, le spectacle de nos troupes en retraite. Elles sont suivies par les troupes alliées qui arrivent le 29 juin ; essentiellement prussiennes, elles traversent la Seine à la hauteur de Poissy et de Conflans (40 000 hommes et 20 000 chevaux) et occupent Saint Germain où elles bivouaquent dans la forêt. Le feld-maréchal Blücher envoie des cavaliers en reconnaissance vers Versailles : ils entrent dans la ville, y passent la nuit et, le lendemain, poursuivent leur route vers Vélisy ; leur rencontre avec des éléments de la cavalerie française, qui les repoussent à travers Versailles, se termine par un violent combat sur la route de Versailles à Saint Germain à la hauteur de Rocquencourt.
Le 6 juillet, les troupes alliées sont dans Paris et, deux jours plus tard, Louis XVIII est de retour aux Tuileries.
Villennes va connaître une seconde occupation mais cette fois par les troupes prussiennes. Plus de 5 000 hommes et un millier de chevaux séjournent dans le village du 15 juillet au 15 octobre 1815 ; les frais d’occupation s’élèveront à 7 695,55 francs. Quelques mois plus tard, une déclaration du maire fera état d’une demande d’indemnisation pour pillage s’élevant à 2 227,70 francs, concernant 35 habitants de la commune.
Si les chambres ont exigé l’abdication, elles ont tenté de proclamer Napoléon II, montrant ainsi leur refus de l’Empereur mais aussi celui du roi, leur volonté étant de parvenir à une monarchie constitutionnelle et parlementaire.
La défaite ouvre la voie à une seconde restauration des Bourbons. Mais cette fois les choses sont claires : Louis XVIII revient dans les fourgons de l’étranger !
L’entracte des Cent Jours étant clos, la Restauration reprend son cours ...