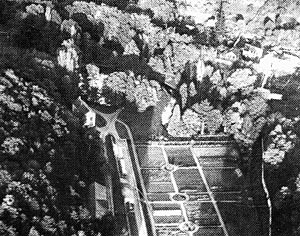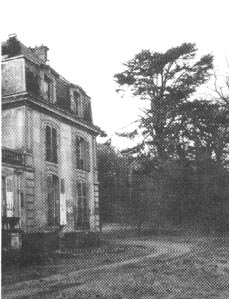Corine de Royer, arrière-petite-fille d'Alexandre Bordes, a écrit un roman "La boîte à rouille", inspiré par ses souvenirs d'enfance et par les événements qui ont conduit à la destruction du château de Migneaux.
Elle en a extrait, en 1993, le document nostalgique et historique qui suit, publié dans le numéro 29-30 (Printemps-été 1994) de la revue CHRONOS, consacré à Migneaux, du Cercle d'Etudes Historiques et Archéologiques de Poissy. Nous remercions les responsables de cette association, amie et voisine, de nous avoir autorisés à le reproduire, ainsi que les illustrations (nous avons apporté quelques corrections et ajouté les titres).
Dans son introduction, l'auteur écrivait :
"Le château de Migneaux et sa forêt ont bercé mon existence de 1950 à 1982, grâce à l'amour d'une femme, Jacqueline Bordes Béquette, ma grand-mère. A sa mort, en décembre 81, arbres et bâtiments ont ployé la tête. Ils ne sont pas encore relevé.
J'ai alors pensé ne jamais pouvoir me détacher de ce lieu. Pour être sûre de ne pas oublier ce qui avait fait un jour mon bonheur, j'ai consigné dans un roman d'une manière déguisée, sous de faux noms, ces descriptions de Migneaux dont je restitue ici quelques extraits en clair [...]."
|
Migneaux était un labyrinthe forestier d'une cinquantaine d'hectares. La proximité de Paris rendait exceptionnelle sa végétation naturelle, protégée du tumulte de la civilisation par une enceinte de pierre de deux mètres de haut. Le domaine avait été acquis en trois fois par Alexandre Bordes, de la Compagnie "Antoine-Dominique Bordes et Fils", le plus grand armement de la marine à voile du monde. Sous leur prestigieux pavillon avaient navigué 126 trois et quatre-mâts barque et un cinq-mâts, ''France", sur tous les océans du monde entre 1835 et 1935, bravant le Cap Horn des milliers de fois. Mises bout à bout, les voiles d'un seul de ces navires pouvaient couvrir la distance entre Paris et Bordeaux. Le crucifix, la boussole, le chronomètre et la sonde étaient leurs seuls guides, comme à l'époque de Christophe Colomb. Migneaux était devenu le port d'ancrage de notre famille voyageuse. A la mort d'Alexandre Bordes, le domaine a été redivisé entre ses trois enfants : le vieux château en pierre meulière du XVIIème siècle à sa fille aînée, Jacqueline ; l'Orangerie à son fils Alexandre ; et la vieille maison de Fauveau où l'on s'éclairait encore à la lampe à pétrole, à Hélène. Outre leur beauté singulière et intrinsèque, ces trois lieux n'en constituaient qu'un sur le plan affectif dans le souvenir de leurs habitants. Cet assemblage de parcelles disparates était une entité plus forte que la famille qui y séjournait. "Les Aborigènes ne possèdent pas la terre, la terre les possède'', disent les Australiens. Et Migneaux, où s'installait chaque été ma grand-mère de la Saint-Jean à la Toussaint, avait à mes yeux, la même puissance. Sa beauté était magique. Le château de ma grand-mère, ses habitants et les amis de passage Le château ne préoccupait guère ma grand-mère. Il n'était que le reflet des activités menées à l'extérieur, en pleine nature. Chaque armure était bondée de cartouches, de ficelle, de rafia, de nids d'oiseaux, de fossiles, de sigillaires, de zizyphi, de mottes de beurre préhistoriques, de puddings ferrugineux, de racines aux formes étranges, de cucurbitacées sèches, de vieux journaux et de pots de confiture vides. Dans la salle à manger, il y avait des claies à noix, une desserte "Empire" couverte de médicaments variés entremêlés de jarres de piments et de graines de capucines et, sur la grande table, trônait un immense bouquet composé de la moitié de la forêt et du potager. Pour accéder au grand salon, il fallait se munir d'une lampe électrique. Nous y allions pour faire provision de pommes triées en plusieurs catégories. Mais pour arriver jusque là, il fallait enjamber une énorme balance, contourner le buste d'Antoine-Dominique Bordes qui trône aujourd'hui au Musée des Cap-Horniers dans la tour Solidor à Saint-Servan, sauter par-dessus une roue de bicyclette. Aucune fenêtre ne s'ouvrait jamais et l'on sortait de ce sanctuaire couvert de poussière, le nez plein d'une bonne odeur de moisi, la figure giflée par une branche de physalis pendue la tête en bas pour les bouquets d'hiver. Ma grand-mère aimait confectionner des gâteaux de châtaignes ou de maïs, ou même des ''pies'' anglais pour ses amis. Certains vivaient là en permanence comme le prince Obolenski et Baba son épouse. Mes parents l'avaient connue à l'Hôpital américain où elle était infirmière. J'ai vu le jour entre ses mains, les mains de la Sainte Russie. Obolenski avait fait partie de la garde du Tsar. Il était grand et beau avec des yeux tristes de cocker brun. Il n'avait qu'un poumon. L'autre était malade. Leur fils était danseur dans la Compagnie du Marquis de Cuevas. Quand ma grand-mère est allée voir où ils habitaient, elle a découvert un large matelas crevé, pour trois personnes, sous un escalier minable, sans fenêtre ni chauffage. Ils ne se plaignaient jamais. Elle leur a offert d'habiter avec nous en 1950, et comme il y avait de vieux buis merveilleux à sculpter, ils sont restés. [...] Les amis d'un soir ou d'un après-midi étaient Vera qui chantait en s'accompagnant au piano les chansons de la vieille Russie et nous décrivait l'incroyable raffinement de son éducation dans un collège de jeunes filles à Saint-Petersbourg. Cette russe était une rescapée du temps où ma grand-mère avait transformé son grand salon parisien en atelier pour les artistes réfugiés, en 1918. Il y avait aussi l'ambassadeur François-Poncet et tante Tatine, son épouse, Jacqueline et Georgette Deutsche de la Meurthe, Madame d'Humières et Louis Renaud, suivant les époques. Le jardin et la forêt de ma grand-mère Mais le plus clair de son temps, ma grand-mère le passait, en sauvage, au jardin. Il suffisait de remonter le tuyau d'arrosage, à la tombée du jour, pour la trouver en train d'orienter le jet d'eau aux pieds d'arbres fruitiers taillés en espalier, de pivoines japonaises ou de groseilliers qu'elle avait recouverts de filets à crevettes pour les soustraire aux becs des moineaux. Ou bien elle était dans la forêt, occupée à chasser le pigeon et le braconnier, tantôt avec son "12", tantôt avec son "16", toujours tentée d'utiliser un peu de chevrotine, manière d'entretenir les relations avec les voisins. Elle reconnaissait chaque coulée de renard, chaque chemin de biche, les heures de passage, les perchoirs des pigeons, les placers des coulemelles au pied tigré ou excoriées, de lépiotes pudiques et fibrilleuses, d'armillaires couleur miel à saveur âcre et atypique, de collybies, de russules alutacées et de trompettes de la mort.
Mes frayeurs de petite fille Seule des mois entiers dans la grande maison, elle n'avait pas peur : la préfecture de police lui avait donné l'autorisation de porter un couteau à la lame plus longue que la largeur de la paume de sa main, et elle savait qu'en cas d'attaque nocturne, il suffisait de deux coups de semonce avant de tirer dans le tas.
Mes craintes de petite fille étaient scandées par les secousses et les halètements des trains qui passaient dans la nuit. Elles prenaient corps après que ma grand-mère eut procédé au rituel de la pose des barres de fer sur chaque fenêtre et sur chaque porte. Les pièces s'assombrissaient une à une et les sons s'amplifiaient : crissements de pneus sur l'autoroute, moteurs d'hélicoptères, sirènes des ambulances et de la prison de Poissy. Il était impossible d'oublier que cet espace vert à 20 minutes de Paris était entouré de cités-dortoirs conçues pour abriter les ouvriers des usines environnantes. A en croire ma grand-mère, nous vivions sous une menace permanente. Mais le temps où elle allait à la messe avec Evelyn, sa fille, et Madeleine Bordes, sa mère, en voiture à cheval à Villennes n'était pas si loin. Nos amis les animaux et les autres invités Elle nous racontait comment elle avait élevé un marcassin, Jacob, qui était la terreur du jardinier et d'Alexandre. Le jardinier ne se déplaçait jamais sans une échelle pour escalader le premier arbre venu dès l'apparition du monstre. Ma grand-mère surveillait le manège depuis le perron gris où elle étudiait au soleil en compagnie de Mademoiselle Vincendon qui habitait au château. Sous ses cheveux, elle dissimulait un rouge-gorge qui participait à sa manière aux leçons. À l'heure du goûter, elle montait à travers bois jusqu'au bassin de Fauveau pour tendre sa tartine beurrée au ras de l'eau verdâtre. Un poisson rouge y sautait, puis l'animal sur canapé réintégrait quelques secondes plus tard son milieu naturel et obtenait quelques miettes de récompense. Sur ce bassin, Alexandre, Antonin et Adolphe, le triumvirat de la Compagnie Bordes, organisaient des combats navals avec les maquettes de leurs anciens navires. Il y avait toujours beaucoup d'invités du monde entier à Migneaux : ambassadeurs, grands industriels, généraux et pionnières de l'aviation se succédaient. Deux immenses potagers et deux vaches, Marjolaine et Giroflée, nourrissaient tout ce beau monde. La famille et Migneaux pendant les deux guerres Quand la première guerre mondiale avait éclaté, Jacqueline Bordes était rentrée à Paris pour s'occuper de 147 Poilus dont elle était la marraine. Jacob avait été donné au Jardin des Plantes. Jacqueline avait perdu son fiancé le dernier jour de la guerre et épousé James Béquette, un officier de la Marine américaine, sept ans plus tard. [...] Pendant la deuxième guerre, deux séries d'Allemands sont venues à Migneaux. Ceux de l'Ecole d'Equitation de Hanovre et des S.S. Les premiers n'ont rien abîmé d'autant plus que Migneaux était sous la protection du gouvernement espagnol grâce à André Lataillade, le mari d'Hélène. Les seconds ont tout saccagé y compris les marbres de cheminée en cassant des noisettes à coups de marteau. Ma grand-mère me l'a dit un jour qu'elle avait décidé de brûler des centaines de lettres, sa correspondance avec tes Poilus, alors que nous faisions griller des châtaignes [...] La famille s'était réfugiée clans la grotte avec le jardinier et les vaches, Marjolaine et Giroflée. Un Italien avait été caché dans la glacière. [...] Evelyn Béquette, mère, fille aînée de Jacqueline Bordes, avait un passeport américain. Sa valise était toujours prête au cas où les Allemands le découvriraient. [...] Toutes ces bribes étaient entrées dans la légende familiale, sans grands repères de dates. Ce bloc de mémoire était indivisible parce que son morcellement, c'est-à-dire son questionnement aurait mis en danger l'équilibre établi, en révélant les conflits personnels et politiques de cette famille à l'image de la France de l'époque. La devise de la Compagnie Bordes était "Union et Persévérance" et chacun s'attachait du mieux qu'il pouvait à la mettre en application. Mes vacances dans l'Orangerie de l'oncle Alexandre Mes parents me confiaient à ma grand-mère pendant les vacances. Mes peurs dataient de ce temps-là. Et à force d'évoquer le loup, il est venu. C'est chez l'oncle Alexandre que la menace évoquée par ma grand-mère s'est abattue. Elle annonçait le craquèlement de notre empire imaginaire. L'oncle Alexandre n'avait pas de femme. Il n'avait que des souvenirs. Il venait de restaurer la vieille Orangerie du XVIIIème siècle. Le rez-de-chaussée avait été découpé en deux immenses pièces éclairées par des baies ogivales à petits carreaux. Au sol, des tommettes rouges peintes au siccatif de mes propres mains de huit ans. C'était mon paradis : elles contenaient une panoplie d'outils exceptionnelle, des bocaux de verre pleins de nitrate du Chili, des sextants, une ancienne caméra à pied et des plaques de verre qui révélaient l'engouement de son père pour la photographie naissante. Et un bateau en plastique pour aller chercher les canards qui tombaient sur l'étang l'hiver. Il y avait aussi des animaux empaillés auxquels est venu s'ajouter le Héron.
J'aide mon oncle à restaurer les serres et le potager J'aimais la compagnie d'Alexandre car je me sentais utile à ses côtés, surtout dans le potager auquel nous tentions de redonner son allure originale. M'en souvenir, c'est donner une dernière étincelle de vie à cet endroit aimé. Comme la prise d'une photo à la chambre. La même lenteur, la même délectation. Un rituel : choisir à tâtons son angle de vue, déterminer son cadre, rectifier les parallélismes en basculant le soufflet, faire la mise au point sur un verre dépoli et aveuglé en pleine lumière comme ma mémoire, mais voyant à l'ombre d'un tissu noir. Il était devenu jungle, mais ses formes étaient encore suggérées par les allées de vieux buis torsadés. Les orties et les ronces avaient envahi la place. Des gerbes d'or pointaient la tête par endroit en s'agglutinant autour d'une mare à fond dallé. Il y avait de l'oseille rejetonne et de vieilles fleurs aux couleurs pastel.
Les deux niveaux du potager étaient réunis par un escalier de fer rouillé. Le troisième niveau était l'allée conduisant à la Porte jaune et à la Plaine. Là, un hangar dissimulait un très long couloir de pierre, mince et voûté ; il s'enfonçait fraîchement dans la muraille calcaire jusqu'à une crypte soutenue par quatre ogivales percées de niches. Des millions de moustiques étaient collés par le nez comme une armada de ventouses. C'était un lieu de culte très ancien qui datait de l'époque mérovingienne et rejoignait les souterrains qui débouchaient sous l'ancien château de Blanche de Castille. Pendant des mois, j'ai restauré ces lieux avec Alexandre. Pour qui ? Pourquoi ? Il ne le savait probablement pas non plus. Mais j'étais parfaitement heureuse, bêchant, grattant, dérouillant, repeignant à ses côtés. [...] Disparition d'Alexandre et de l'Orangerie, la perte de ma terre Alexandre est mort. Deux ans plus tard, Séraphine, la jardinière, a entendu du bruit du côté de l'étang. Deux gamins de quinze ans étaient en train de pourfendre l'Orangerie à la hache. L'un était fils d'un ingénieur de l'E.D.F. à Poissy, l'autre le fils d'un employé de l'Hôpital de Beauregard. Ils ont reconnu les faits. Quelque temps plus tard, j'y suis allée moi aussi [...]. J'ai cherché les outils. Je n'ai trouvé que quelques silex, quelques oursins fossiles mêlés aux gravats et un bocal de nitrate jauni sur un rocher. J'ai eu mal dans ma terre. Sur le sentier de retour, entrecoupé de coulées de biches et de renards, il m'est apparu que je n'avais plus de terre, qu'elle avait changé de matière, d'air et d'eau. Celle que je portais désormais en moi était faite de quelques mottes bu-rwanda, de quelques mottes américaines, de quelques mottes maghrébines. Sa complexité, son éclectisme l'avaient rendue anonyme. Un corsaire balafré s'est dressé an milieu des éboulis et m'a demandé ce que je faisais là et avec quelle permission. Il m'a permis de cueillir une rose. Les gardiens des ruines, des orties et des ronces Vingt ans après, il vivait toujours là au milieu des ruines, louant des parcelles de terrain aux voisins ; ils élevaient des poules et des canards sur des carrés grands comme des mouchoirs de poche arrachés aux orties.
Le nouveau gardien s'est fait tirer dessus, accompagné de ses treize chiens-loups ; Hélène a organisé une expédition punitive dans la Plaine où elle a fait arrêter une dizaine de motards qui s'y reposaient, allongés près de leurs machines de fer aux abords de leur nouveau vélodrome de boue. Puis elle a pris un braque de Weimar en flagrant délit de chasse après les biches affolées, galopant à perdre haleine pour échapper à ses aboiements forcenés. La Plaine s'est enflammée et la carcasse sèche du gingko biloba, l'ancien roi de cette parcelle qui avait dicté sa loi aux arbres environnants depuis plus de cent cinquante ans, s'est élevée en torche avant de se volatiliser dans la fournaise. Le feu s'est arrêté à deux mètres de la maison d'Hélène . [...] Des visiteurs de toutes espèces Mais il y a encore des gens pour pêcher les gardons de vase dans l'étang : un entrepreneur de Poissy, le facteur ; on croise dans les bois toutes sortes de personnages, l'architecte des cités ouvrières environnantes qui rêve sur une souche et vient là tous les dimanches, un policier qui a demandé à être garde-chasse, des fleuristes qui viennent s'approvisionner en feuilles de lierre pour leurs garnitures, de champignonneurs, des ramasseurs de châtaignes. Le terrain est gelé ; pas de permis de construire ; l'autoroute approche. Il n'aurait jamais fallu tuer le Héron, mais les corbeaux sont venus d'eux-mêmes. Ma grand-mère se prépare pour l'éternité à Migneaux Deux années s'écoulèrent ainsi au cours desquelles mes visites à ma grand-mère se rapprochaient. Elle souffrait d'une migraine permanente et la nuit, quand elle avait un malaise, elle agitait la cloche de bord de la "Jacqueline", le quatre-mâts barque construit aux chantiers navals de la Seyne, dont elle avait été la marraine lors de son lancement en 1896 [...]. Elle avait glissé son corps devenu si léger sous une paire de ses fameux châles à grands décors de Sîmorg, l'aigle persan de la résurrection, version chinoise, comme si c'était là qu'allait se tenir la prochaine conférence des oiseaux. Ses cheveux blancs descendaient jusqu'à la taille et l'éclat de ses yeux bleus, sous de lourdes paupières assombries, nous confondait ; ils reflétaient les teintes de la marine suspendue à la tête de son lit laqué de rouge. Un mélange de tempête et d'accalmie, de voiles qui attendent une bourrasque pour se mettre à faseyer avant de disparaître l'horizon. Comme elle savait que ses cendres ne pouvaient être jetées par-dessus bord, elle avait ordonné que son cercueil soit descendu au fond d'un ancien puits de pierre de Migneaux, au beau milieu du terrain pentu et boisé qui dominait son château, à la croisée des chemins empruntés par les biches pour transiter sur le territoire d'Alexandre. Elle voulait donner son corps en pâture aux grands arbres, pour que son sang soit sanctifié en terreau fertile. Ainsi pourrait-elle sentir encore longtemps la griffe du pigeon tendre prendre appui sur elle, avant de s'enfuir dans un battement d'ailes froufrouteux, à l'écoute du pas du chasseur, son petit-fils. Elle voulait s'enfoncer toujours plus loin dans cette terre. Avec la même mesure et le même sens du sacré qu'un Aborigène s'adonnant au "walk about", elle se l'était appropriée en y cheminant rituellement. Son souhait était de reposer à proximité d'Acqueviîlle, le domaine des Lassuchette, ses amies d'enfance. Que le château des Lassuchette vienne d'être adjugé à un marchand de bois, les héritiers l'ayant trouvé inhabitable faute du chauffage central dont on l'avait dispensé pour préserver les marqueteries, lui était devenu indifférent. La tempête et le gel massacrent la forêt
L'expédition de mes cousins et leur macabre découverte Ce jour-là, l'un des petits fils de Jacqueline Bordes partit pour Migneaux, accompagné d'un des fils d'Alexandre, pour mesurer l'étendue des dégâts ; ils marchaient seuls dans la forêt, leurs croquenots bien cirés recupérés de l'armée écrasant la glace, chacun un fusil à la main, un pistolet et un couteau à la ceinture, sur de vieilles tenues de parachutistes, avec l'idée de descendre l'un de ces pigeons si visibles dans la forêt dénudée. Le nez en l'air, ils marchèrent jusqu'à la frontière du territoire de Jacqueline et Alexandre Bordes, marquée dans un moment de colère par une ligne de fil de fer barbelé. A l'endroit aplati par le passage des braconniers, ils dévalèrent le promontoire calcaire jusqu'aux ruines de l'Orangerie, ameutant les deux chiens enchaînés de l'Arabe. Il les trouvèrent bien maigres, l'œil torve et les babines salement dégoulinantes de morve. Ils hélèrent l'Arabe, "pour ne pas prendre un pet au passage'', se dirent-ils en parodiant l'accent du Midi pour se donner du cœur au ventre. Comme ils n'obtenaient aucune réponse, ils poussèrent jusqu'aux jardinets sous-loués à quelques voisins, plaisantèrent encore à l'idée de ramener une poule de basse-cour faute d'avoir encore descendu un pigeon. Puis ils rebroussèrent chemin vers les ruines qui étaient depuis dix ans la demeure de l'Arabe, devisant mais riant jaune, aux aguets. L'Arabe n'avait pourtant pas l'habitude de s'éloigner de son bastion ouvert à tous vents. Dans une puanteur effroyable, l'Arabe gisait sur sa couche de torchons, la tête recouverte d'un lambeau de tapis de prière. Celui-ci soulevé avec un doigt, deux autres sur le nez, ils découvrirent sa tête fracassée [...]. Cela leur rappela la dérouille d'un grand cerf qu'ils avaient trouvée, un jour, dans la forêt, couverte de mouches bleues. Cette fois là, ils n'avaient pas résisté à la tentation de découper le massacre (en vénerie, tête et bois de cerf) à la scie malgré leur dégoût devant la multitude de vers grouillants et dodus, puis l'avaient enfournée dans un sac poubelle. Au fond d'une vieille cocotte, ils l'avaient blanchie à grand renfort d'eau de Javel avant de la suspendre aux murs du salon. L'animal était âgé de dix ans et portait des bois d'une fort belle taille. Mais dans ce cas précis, il n'y avait rien d'autre à faire qu'un signe de croix avant de convoquer la maréchaussée. Il fallut plusieurs jours pour découvrir les auteurs du crime : deux adolescents échappés d'une maison de redressement, à court d'argent, s'étaient mis à visiter les vieillards repérés entre Dinard et Poissy où ils furent pris en flagrant délit de vol à main armée. Ils n'eurent plus qu'à avouer le premier meurtre de leur existence et son mobile financier. Disparition de ma grand-mère puis de ma mère Ma grand-mère s'éteignit boulevard Malesherbes sans avoir été informée de la tempête de gel ni du massacre de la forêt. La messe d'enterrement fut célébrée à Saint-Augustin, face au mess des Armées et, incidemment face à l'ancien poste d'observation de l'espion polonais Trepper. L'assistance était réduite à un petit nombre d'intimes, selon ses souhaits. Elle avait la foi du charbonnier mats l'Eglise l'avait déçue. Elle préférait Sainte Thérèse de Lisieux qui avait si bien protégé ses 147 Poilus. J'étais bouleversée car cet enterrement là préfigurait celui de ma mère. La poutre maîtresse de la famille avait cédé. Elle ouvrait une porte béante sur l'abîme et allait entraîner Evelyn dans sa chute. L'eau de la source de Migneaux continue à couler Dix ans plus tard, la nostalgie m'a quittée. La tristesse du décès de ma grand-mère s'est estompée. Grâce à nos prières, son âme, comme celles de toute la lignée qui m'a précédée, est dans la lumière et éclaire à nouveau de sa bienveillante présence cet espace qui fut un temps les territoires de Saint Louis et de sa mère Blanche de Castille. Cet ouvrage, où chacun a porté un instant un regard d'amour sur ses souvenirs de famille partagés sur ce domaine, en est la preuve. Il est aussi l'annonce de la renaissance de ce lieu, riche en nappes phréatiques. L'eau, c'est la vie. Migneaux vient du latin Magnae Acquae. Il y avait là, plus loin que mémoire d'homme, un culte dédié à l'eau. La source qui jaillit encore près du château et à laquelle, enfants, nous allions nous abreuver, était pure et bénéfique. Elle débitait 3000 litres à l'heure dans la Seine en 1976. Grâce à ma grand-mère et à la tendresse qu'elle vouait à ce lieu, j'ai appris à écouter la terre, à entendre la souffrance de la nature quand les hommes ne savent plus la relier à l'univers dont elle fait partie. Tchernobyl est très spectaculaire. La perte de la connaissance chez les hommes est beaucoup moins tapageuse. Elle se dégrade au fil des générations comme un fil de plus en plus ténu. Elle se mesure aux maladies des gens, à l'éclatement des familles, à la destruction de l'environnement, à la violence latente. Mais il suffit d'un regard d'amour vrai pour inverser le processus. Cet ouvrage est ce regard qui permettra aux habitants de Poissy et de Villennes d'être les témoins de la renaissance de ce lieu grâce aux initiatives individuelles ou associatives qu'il suggérera à ses lecteurs. Il y a des lieux et des eaux qui soignent. Simplement parce que les hommes les ont aimés. Chacun est concerné aujourd'hui par ce bastion de verdure qu'est Migneaux où les eaux, les terreaux et les grands arbres se sentent encore bien seuls pour jouer leur rôle de poumon, de filtre de l'air, ce souffle qui anime chaque enfant de la périphérie. Paris, le 12 décembre 1993 |